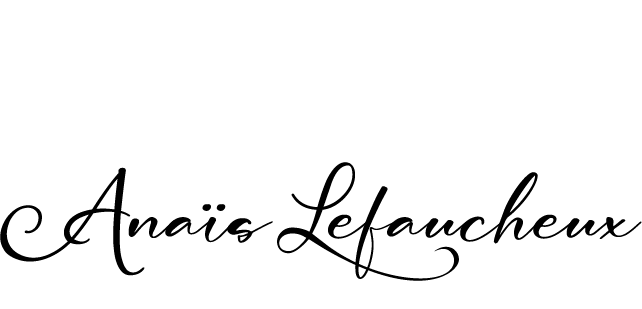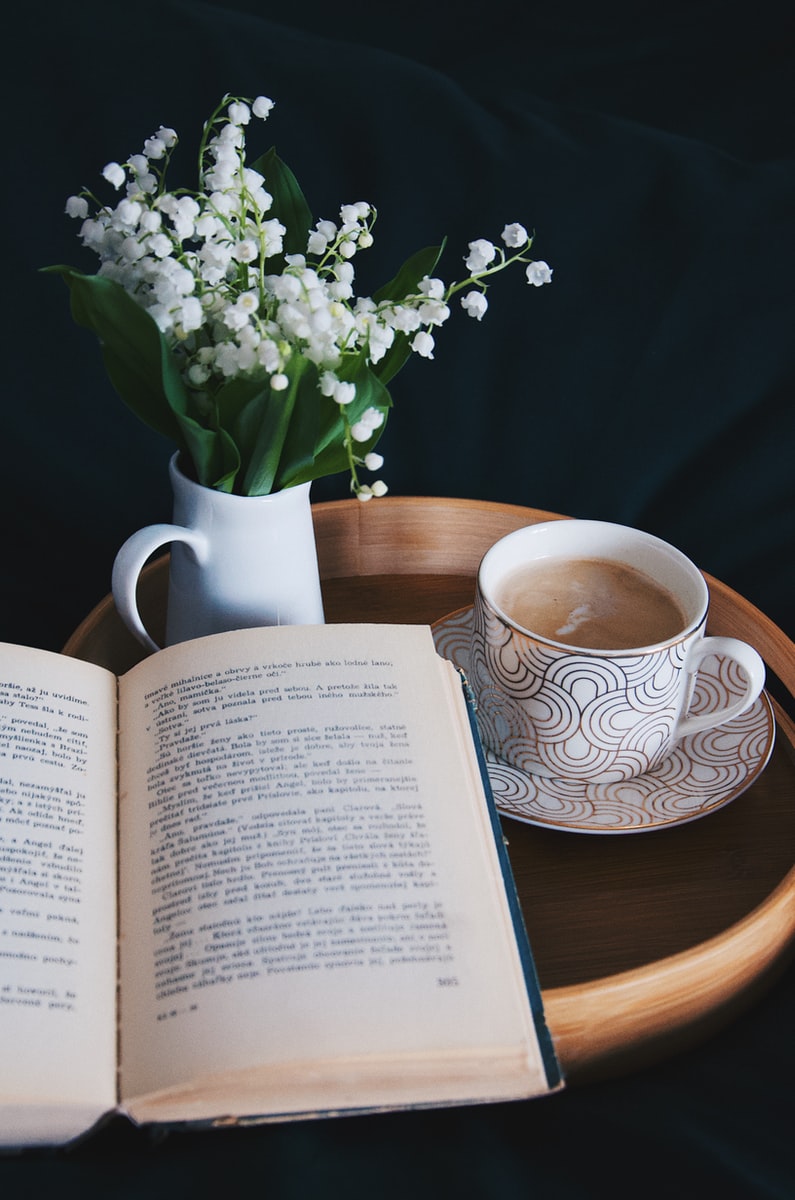Heq-xtraordinaire
Le don de raconter était un des plus grands cadeaux qu’une personne puisse recevoir des esprits, puisque ceux-ci ne pouvaient se faire entendre qu’au travers des conteurs.
L’écrivain danois Jorn Riel a passé 16 ans à arpenter le Groenland et il en est revenu des histoires plein le cœur et l’esprit. Sur conseil enthousiaste de mon frère Louis (toujours bien avisé quand il s’agit de lectures) j’ai donc fait un sort au tome 1 de sa trilogie inuit, avec ce premie roman, « Heq, Le chant pour celui qui désire vivre ».
Cette sagesse se trouvait dans le chant, ce chant qui résonne dans les oreilles de certains fils des hommes. Le chant qui naît dans la toundra déserte et qui est si différent du langage ordinaire. C’étaient des chants qui n’appartenaient qu’à leur propriétaire, de même que sa respiration n’appartient qu’à lui, et ils naissaient de la solitude, de la souffrance et du manque pour se transformer en sagesse.
Le récit se déroule très loin, il y a très longtemps, des milliers d’années, des temps reculés, au-delà de toute mémoire. Un temps où les animaux n’ont pas même peur de l’Homme. Heureusement, il y a les conteurs et la tradition orale qui permettent de se faire une idée des pérégrinations, aventures et tribulations des peuplades du Grand Nord, entre nomadisme et sédentarité. Nous suivons, ébahis et éblouis, la tribu de Heq, leur vie dans des igloos à chasser et manger du caribou, du phoque ou du bœuf musqué, à s’échanger (ou se voler) leurs femmes, à chanter, à interpréter rêves et signes, à danser et contempler leur environnement, à écouter les anciens raconter leurs souvenirs, dans une harmonie complète avec la nature.
À priori, rien de commun entre le lecteur de 2024 et ces individus sauvages aux mœurs primitives (la moindre attaque entre tribus est l’occasion d’un cannibalisme décomplexé, les uns dévorant les viscères de leurs ennemis…) – et pourtant. Protéger sa famille, ressentir de la joie devant les jeux des enfants, partir chasser pour sustenter les siens, mettre au point le prochain voyage, construire un arc, siroter des poches de graisse fondue, manger en groupe, aimer sa compagne, vivre des instants sensuels, désirer se venger, recueillir les orphelins.. il n’y a pas « si » loin, au fond, entre eux et nous.
Quand quelqu’un voyage, il apprend beaucoup de choses sur lui-même. Si on va là où il n’y a que solitude, on apprend à vivre sans plainte. Car plus on pénètre dans la solitude en voyageant dans les beaux pays du monde, plus on devient petit. C’est ainsi que ton âme aura la compréhension du tout, si tu lui laisses le droit de chercher.
Le roman est traversé d’une spiritualité merveilleuse quasi « panthéiste », on assiste à des chants au tambour et autres invocations d’esprits, ces derniers qui sont omniprésents dans le quotidien des inuits (merci au glossaire de fin) et expliquent les phénomènes naturels (c’est l’âme du vent qui souffle avec violence, par ex).
Tyakutyik, l’un des frères de Heq, est ce qu’on pourrait appeler un « intersexe », une personne « non-binaire », à la fois homme et femme, de corps comme d’esprit. Il finira par trouver une femme plutôt « homme » qui le complétera. Aussi ce récit apparaît-il comme un hymne à la tolérance des différences, qui montre que chacun peut trouver sa place singulière et son alter-ego dans la communauté.
Certains personnages, comme la matriarche Shanuq ou Tewee-soo, ont été arrachés au début de leur vie à leur tribu d’origine puis greffées à la peuplade inuit, sans que cela soit vécu comme une tragédie déchirante. L’individu garde son identité et ses croyances, tout en se fondant à sa nouvelle famille. Même lorsqu’un enfant disparaît, pris par une louve enceinte et affamée, la mère trouve une leçon à en tirer et respecte la loi de la jungle, en somme celle du vivant qui désire se perpétuer. L’homme et l’animal se dévisagent dans un respect mutuel.
On a maintenant vécu si longtemps parmi les Inuit que l’on en oublie presque d’être itqiliit. On mélange tout et on devient comme deux personnes en une. Mais jamais on n’oubliera l’histoire de la montagne blanche et jamais ne s’en ira le souvenir de Manito, qui se transforma en loup et me fit manger de la chair humaine. Aussi je devrais ressentir de la joie au lieu du chagrin, puisque c’est Manito qui a pris ma fille et l’a emmenée avec lui. Et maintenant elle est jeune dans le pays des morts car nous savons tous que plus rien ne change quand on arrive là-bas. (…) Nous avons tous reçu le droit de vivre et c’est pourquoi nous avons aussi l’envie de tuer.
Un grandiose épopée, à la fois exotique, dépaysante et terriblement proche. Superbe. Vivement le suivant !