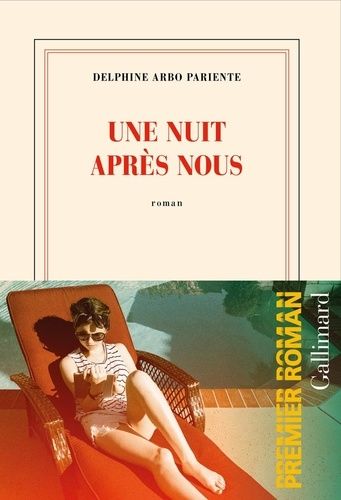Perversion du père
Malgré les questions auxquelles rien ne répond, j’irai chercher les mots de ce jour d’orage.
À lire les extraits qui circulaient, je pensais avoir affaire à une passion adultérine pleine d’étourdissements lyriques et amoureux : je n’y étais pas du tout. Delphine Arbo Pariente, femme aux talents nombreux (qui eut/a plusieurs vies puisque je portais il y a une quinzaine d’années l’un de ses jolis cabas brodés et qu’elle a depuis lancé la marque de bijoux « Nouvel amour ») signe ici un premier roman qui rejoint la famille des œuvres sur l’enfance maltraitée et plus précisément ici, sur l’existence démolie par un père abject aux mains trop baladeuses.
La narratrice, Mona, qui s’exprime à la première personne du singulier (et que, par là même, j’ai eu évidemment tendance à identifier à l’auteur) est une architecte d’intérieur à qui la vie semble sourire, entre Paul, son compagnon très attentionné (qui semble ici presque « la femme » du couple, toujours compréhensif, à l’écoute, aux petits soins et aux fourneaux) et leur fille Rosalie.
À la faveur d’un cours de de tai-chi, Mona rencontre Vincent, le très solaire et bienveillant professeur, qui la fascine et dont elle s’éprend. Elle dit de lui qu’il « remet de la poésie et du souffle dans les vies éreintées », et c’est peut-être ça qui la pousse vers lui. Lui aussi est en couple avec enfants, ils deviennent donc « seulement » amis, ou plutôt confidents, se retrouvant fréquemment pendant des mois dans un café. Et c’est alors qu’éclot en Mona le besoin de raconter « ce jour d’orage », que soudain elle n’est plus « sourde au sonar » et à la voix de l’enfant intérieur qui crie en elle et qu’elle entend enfin.
Elle comprend aussi, dans une très belle formule, qu’elle aime Vincent « non pour oublier mais pour [se] souvenir. » Se souvenir de son enfance à elle, mais aussi de celle de sa mère, l’éternel mystère, enfuie de Tunisie avec ses parents dans les années 60. Un exil douloureux et une plaie jamais suturée qui répandent leur mélancolie déracinée sur les générations suivantes :
Le passé ne suffit pas à dire ce que je suis mais il a tatoué le présent.
Qu’est-ce qui fait qu’un étranger va alors donner cette confiance face à l’aveu ? Le lecteur ne le saura pas vraiment. Une intuition, un élan, une attirance inexplicables et voilà Mona prête à s’ouvrir enfin sur ce secret qui l’écorche vive et en silence depuis ses 11 ans. Elle dira aussi cet amour naissant, en des mots très beaux, comme une invitation au voyage :
J’avais l’impression d’avoir mis jusqu’alors mon cœur dans un freezer. J’avais envie de le revoir, il venait du vent. J’aimais qu’il soit entré dans ma vie sans que je l’aie jamais attendu ni espéré. Il était apparu, un voilier au fond des yeux. J’aimais qu’il fût curieux de moi, il ne voulait pas seulement me connaître, il voulait me savoir, cherchant, sous les popelines, le plus intime de mes visages.
Nous remontons alors le temps pour rencontrer la petite Mona et sa vie misérable aux côtés d’un père brutal et d’une mère effacée, dont le quotidien s’étire et s’étiole entre combines et larcins parentaux et maltraitance de la fillette. J’ai plusieurs fois pensé à « Orléans » de Yann Moix : certes, Mona ne se fait pas battre comme plâtre comme le narrateur, mais elle subit comme lui d’intolérables brimades de la part de son père qui sont d’une violence inouïe. La mère n’intervient jamais, et c’est peut-être aussi un des détails qui m’a le plus choquée. L’enfant vit quelques parenthèses de douceur lorsqu’elle est invitée chez son amie et goûte aux plaisirs d’une vraie famille, avec vrais repas, draps propres et parents attentifs.
Le lecteur ne peut qu’être extrêmement touché par ce témoignage d’enfant martyr et apeuré qui grandit dans une atmosphère de terreur et d’humiliations répétées. La narratrice passe beaucoup de temps à raconter les épisodes de vols dans les magasins, qui nous prouvent que l’enfant (même maltraité) fera tout pour être aimé de ses parents et susciter leurs encouragements, leur admiration. Le passage où père et fille se font attraper et où la gamine est contrainte de se déshabiller sous les regards concupiscents des vigiles m’a écœurée, et le mot est faible. Surtout que le père n’a pas non plus son œil dans sa poche.
Et c’est là qu’on touche au cœur sordide de ce récit : les regards équivoques du père sur sa fille prépubère vont franchir un cran le jour de la naissance du petit frère. Mona a 11 ans et subit une douche forcée ignoble de la part de son père qui la marquera au fer rouge, la traumatisera à jamais.
J’écris parce que j’ai cessé de croire que je pouvais laisser cette histoire hors de moi.
Difficile de dire qu’on aime un texte qui décrit une réalité aussi effroyable, difficile aussi de lutter contre le dégoût et la rage que nous inspire cet individu, mais heureusement il y a la langue de Delphine Arbo Pariente pour adoucir, presque « euphémiser » l’insoutenable réel. Le style employé par l’auteur est extrêmement gracieux, plein de superbes trouvailles et d’une grande poésie.
Pas de doute, Delphine Arbo Pariente a une très belle plume. Mais cette écriture pèche presque par son excès d’élégance, par ses images trop empruntées, par ses métaphores parfois envahissantes qui manquent un peu de naturel. C’est un peu ce que j’appelle le syndrome « première de la classe » : l’envie de faire de très belles phrases, d’avoir la rédaction la plus éclatante conduit parfois à un verbe manquant d’authenticité. Une prose superbe mais un peu « poseuse », légèrement maniérée. Servie trop généreusement, la beauté peut aussi être indigeste.
C’est le seul bémol que je relève dans ce premier « roman ». Néanmoins, et même s’il faudra que l’auteur kill [her] darlings pour le prochain, cela n’enlève rien à l’intensité de cette confession blessée qui s’inscrit dans la lignée de celles de Jules Renard, Yann Moix ou Adélaïde Bon et qui illustre, si besoin en était, les pouvoirs guérisseurs et « exorcisants » de l’écriture. L’auteur dit aussi fort bien l’abandon, le dévoilement intime que représente l’écriture :
Mes secrets, si je les dis, je ne sais pas ce qu’ils vont devenir.
Loin d’être le roman passionnel et sulfureux que je pensais, « Une nuit après nous » est cette quête du dire, d’écoute et de vérité qui sourd en tout être aux blessures anciennes jamais refermées. Et nous dit plus que jamais que l’écriture est une planche de salut, une « planche de vivre » comme nulle autre.
Bouleversant.