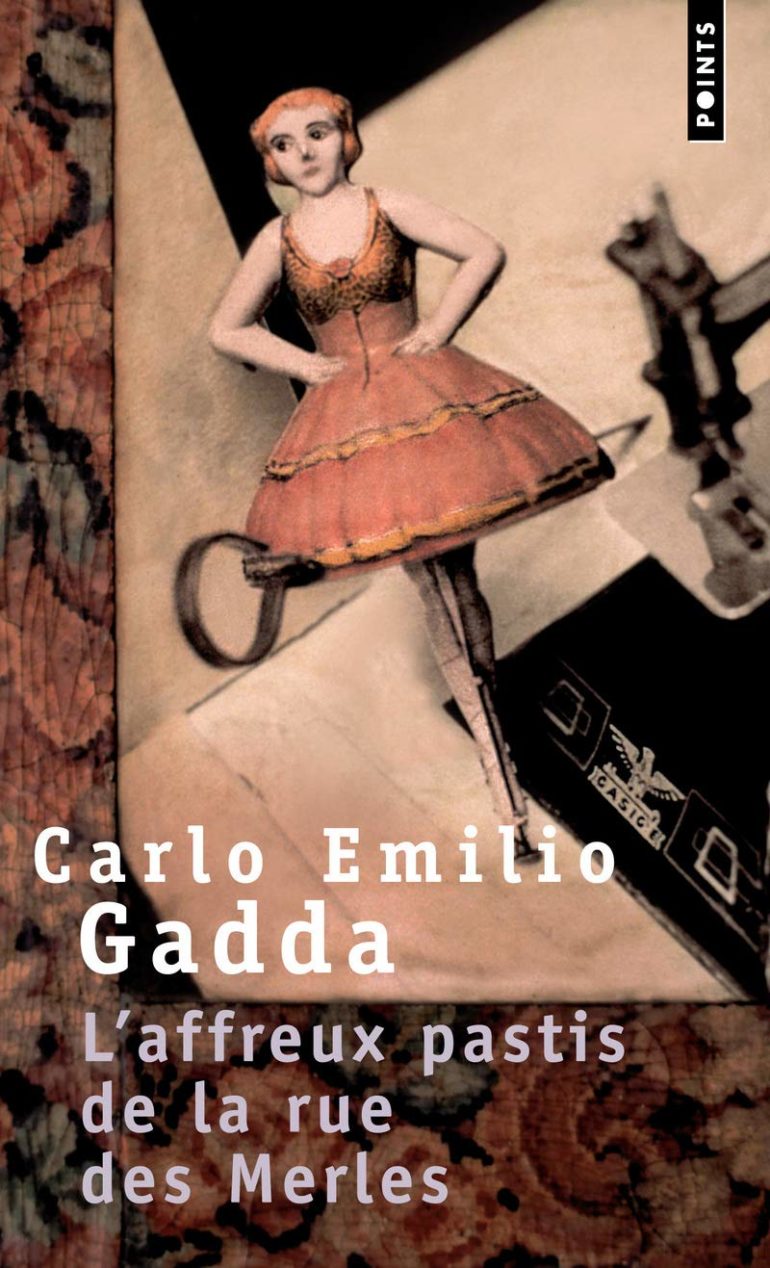Jactances romaines
N’eût été le texte que Philippe Bordas lui a consacré (« Le célibataire absolu » – dans lequel j’ai grande envie de plonger) sans doute n’aurais-je jamais entendu parler de Carlo Emilio Gadda, pourtant considéré comme le pendant transalpin de Céline et de Joyce.
Voilà un roman qui m’aura donné tant de fils à retordre en termes de compréhension pure et simple que, malgré d’éclatantes qualités, j’en arrête la lecture à un peu plus de la moitié. Détail qui m’a d’ailleurs rappelé mon expérience de lecture d’Ulysse de Joyce, dont je n’ai, pire encore, jamais reussi à dépasser les premières pages.
La « faute » à une langue (souvent) trop hermétique, dont le lexique érudit à l’extrême, le mélange de dialectes, de parler oral, d’incursions de grec, de latin, de formes d’ancien français, d’accents venus de nulle part et d’argot pour experts, peut finir par égarer le lecteur le plus motivé. J’ai mieux compris en le lisant pourquoi Carlo Emilio Gadda était quasiment inconnu en France : la traduction française- une véritable œuvre d’art de Louis Bonalumi- demeure d’une très grande exigence et même les lecteurs les plus cultivés, les plus avertis peuvent s’y casser les dents.
« Lupercale », « épigastre », « anaphonèse », « sabellienne », « avecque », « doncque », « anadromes », « pyroscaphes », « acromégale » « atellane », « fescennienne »… ne sont que d’infimes exemples piochés ça et là au fil des pages et qui illustrent le côté virtuose, baroque et bariolé de la langue employée par Gadda. J’ai, hélas, trop peiné sur la forme pour réussir pleinement à me consacrer au fond, ce qui m’a beaucoup agacée.
L’intrigue est assez simple : dans un même immeuble, ont lieu, à quelques jours d’intervalle, un cambriolage avec vol de bijoux (une vieille comtesse qui a toujours vécu dans cette crainte de l’intrusion et dont Gadda dresse un portrait d’une drôlerie formidable qui m’a fait rire à haute voix dans mon lit: « Elle frémissait de l’âme et du corps, tout imprégnée qu’elle était d’espoirs a posteriori, toute à son rêve et aux sacraments sévices, frôlés, hélas, mais non subis ») puis un meurtre (celui de Liliane Balducci, une riche grenouille de bénitier, dont le drame absolu était l’absence de progéniture malgré un mariage tranquille ; la lecture de son testament, minutieusement rédigé, est un morceau de bravoure). Le portrait que fait d’elle l’auteur est d’une grande beauté.
(…) la noble mélancolie de Madame, dont le regard semblait mystérieusement congédier tout phantasme incongru, instaurer pour les âmes une discipline harmonieuse, presque une musique, une architecture de rêves sur les dérogations ambiguës des sens. (…) En dépit de quelques soupirs mal contenus (parfois) sous d’errantes nuées de tristesse, Madame Liliane était une… une femme des plus désirables. Tous, dans la rue, cueillaient son image. Au crépuscule, dans ce premier abandon de la nuit romaine, si lourd de rêves, à l’heure de rentrer chez soi… voici que fleurissaient vers elle, des encoignures et des trottoirs, particuliers ou collectifs, en hommage, des bouquets de regards : éclairs et flamboyantes oeillades juvéniles, un chuchotis, parfois, qui l’effleurai, murmurante oraison du soir. Il arrivait aussi, en octobre, que de l’évanescente coloration des choses, de la tiédeur des murs, émanât quelque poursuivant impromptu, Hermès voltigeur aux courtes ailes de mystère, ou remonté, qui sait, vers les vivants et leur capitale, par d’étranges Erèbes nécropolitains.
L’enquête policière s’annonce complexe au beau milieu de ce quartier populaire et coloré où tout le monde, de la concierge au garçon boucher de passage, a un avis à donner sur les protagonistes et leurs habitudes, sur le déroulé des événements…
Don Ciccio enregistra illico presto tout ce qu’il put écumer du torrent de ces premières dépositions.
Gadda insuffle une vie formidable à son récit qui fourmille de tant (trop ?) de détails que cela en devient vertigineux. Toutefois l’humour ne quitte jamais les pages de ce roman complexe mais d’une originalité hallucinante dans les formes qu’il emploie (« trompettant du renifloir comme une veuve », « ce foutu tarin planté au beau milieu et propre à susciter instantanément les réflexions informulées de chaque interlocuteur », « dans un superbe tremblement de mamelles bâillonnées à craquer la chemisette »)
Est dépêché sur les lieux Don Ciccio /Ingravallo, un commissaire au flegme charismatique, sorte de Sherlock Holmes à l’élocution paresseuse (élide souvent les consonnes de départ ( » ‘omment ell’ était c’te casquette ?… ») ce qui donne à son phrasé quelque chose de fatigué, de traînant, d’embué- de vraiment drôle et attachant. Gadda semble en fait avoir écrit comme pour le théâtre, comme si ses phrases étaient faites pour être dites et jouées oralement.
Une écriture pleine d’ironie, de sous-entendus, qui parie sur l’intelligence et la culture de ses lecteurs, pourvu qu’ils réussissent à se retrouver dans cette galerie de portraits haute en couleurs (le curé Don Corpi qui remplace tous les-R par des-L, le dottor Fumi qui semble parler avec une patate chaude dans la bouche… ).
Au fil de son enquête sur l’assassinat de son amie Liliane Balducci, Don Ciccio va découvrir notamment la demande surprenante que celle-ci a faite à son cousin, le fringant Giuliano : que celui-ci lui fasse don de son premier enfant. S’ouvre alors toute une réflexion sur la folie à laquelle peut conduire la stérilité chez une femme…
Il entendait signifier qu’un certain mobile passionnel, un soupçon, un degré d’affectivité, dirions-nous aujourd’hui, un certain « quantum d’érotisme » se mêlait toujours aux « affaires d’intérêt », aux délits apparemment les plus éloignés des tempêtes de l’amour.
Dans la préface, il est souligné que la totalité du roman est filée de la métaphore de la fertilité, de la fécondation (des femmes, des terres italiennes…), et c’est en effet ce que j’ai noté également. Certains passages sont d’une beauté stupéfiante, et il est évident que Gadda est un styliste de très haute voltige.
Pour elle, en tous cas, au-delà du Tibre, là-bas, derrière les manoirs en ruine et les blonds vignobles, trônait sur les coteaux, les monts, les plaines d’Italie, comme une immense tripe fécondant, ah, Fallope, deux trompes dodue, bourrées de granules à craquer : le granuleux, l’onctueux, le béatifique caviar des générations. Et de temps à autre, du grand Ovaire, des follicules mûrs s’ouvraient, telles des grenades ; et les grains rubicond, fous d’amoureuse certitude, roulaient vers la Ville Éternelle, roulaient à l’appel du mâle, de l’impulsion vitale, de cette aura spermatique dont se gargarisèrent les ovaristes d’antan.
Il parle également admirablement, avec un luxe virtuose de singularités lexicales, des couleurs et de leurs mille nuances.. Il n’y a qu’à voir comment il décrit les pierres (jaspe, diamants) des bijoux de la victime du meurtre, pierres qui sont autant de possibles pièces à conviction et pommes de discorde dans la famille. Ou quand il décrit les couleurs des carnations, changeantes sous l’effet des émotions (« une tonalité cyanotique, de pervenche étiolée »).
Un jaspe sanguin, une pierre d’un vert sourd, d’un ton lustré, presque de feuille palustre, et qui donnait dans la noblesse de certaines voussures ou tronçons d’arcade, à la façon de cette seigneurie secrète et palatale propre aux architectures du forlanais ou du Mantega, ou aux marmoréennes encadrure, murales, d’Andrea del Castagno : avec d’exiguës veinules d’un cinabre vermillonné comme striures de corail, sang caillé ou quasi, dans la chair verte du songe. En lettres dites gothiques, et ligaturées, entrelacées dans le glyphe, deux initiales, G. V. Au revers, lisse, absolue, la plaquette d’or clair.
Un tableau tonitruant, retentissant, plein de bruits, de voix, de couleurs, d’impressions, de sentiments, de décors et de superstitions, de langues, débordant de voix, de points de vue et de niveaux de lecture, un roman qui est une réflexion sur les us italiens, sur le mariage, sur la fécondité, sur les rumeurs, qui m’a (hélas, trois fois hélas !) un peu laissée sur le bord de la route…
Mais béate d’admiration.
Une diffuse et délicate ovaricité, c’est bien ça, y imprégnait, à elles toutes, la tige de l’âme, comme de très anciennes essences, dans la glèbe et les pâtis de la Marsic, la tige d’une fleur. Longuement comprimées, ces essences, pour déflagrer ensuite en le parfum de la corolle : qu’leur corolle à elles, par contre, c’tait l’nez, qu’elles peuvent moucher quand ça leur prend. Femmes, toutes, et dans l’espoir et la souvenance, et dans la pâleur dure, obstinée, de leur réticence, et dans l’empourprement du non-confiteor…