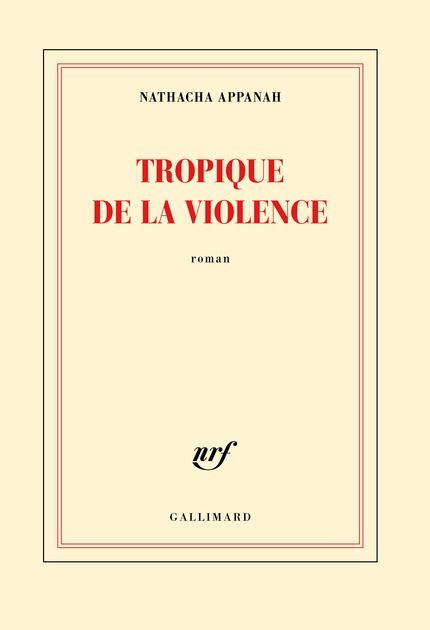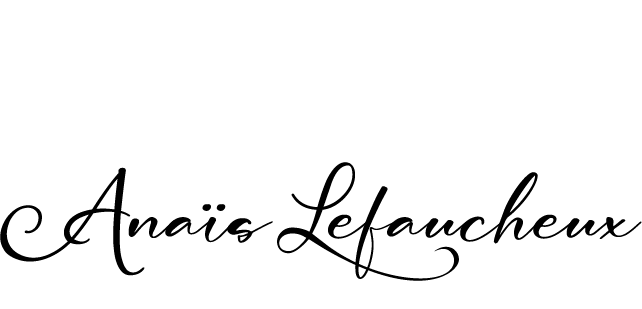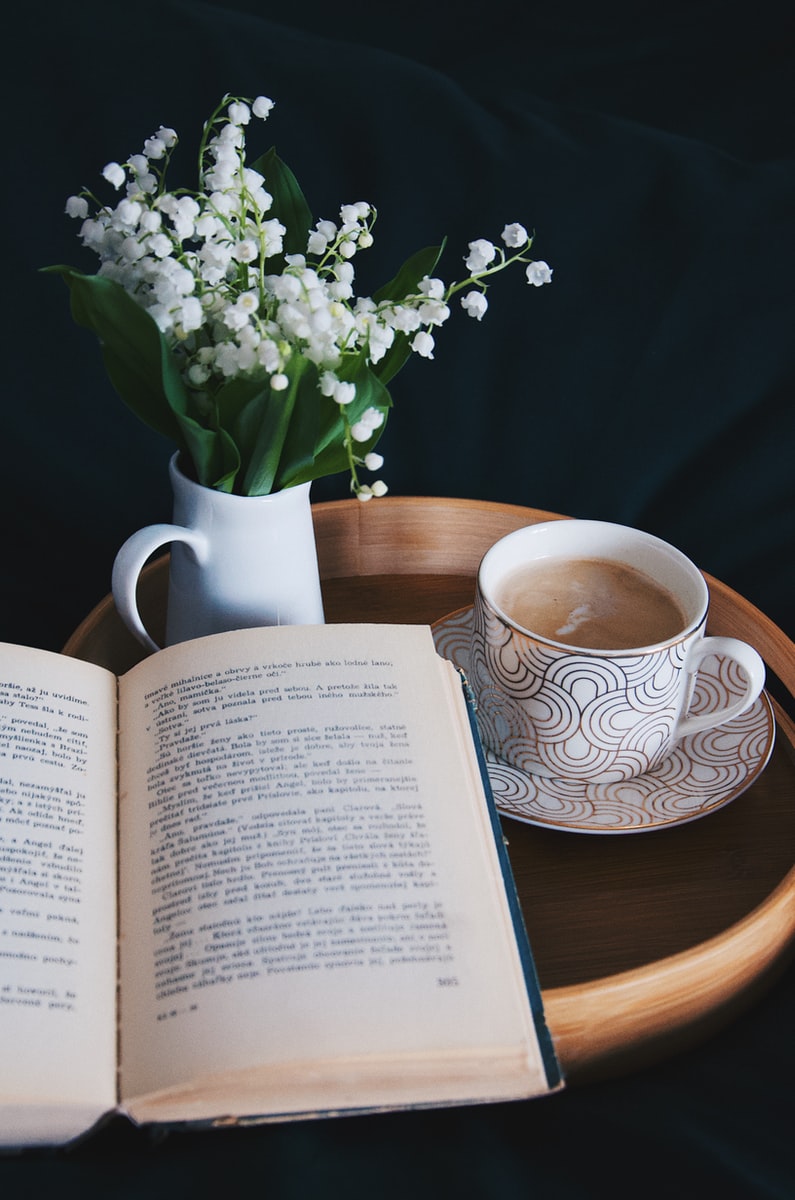L’impossibilité d’une île
Je suis sensible aux dithyrambes. Quand une œuvre enthousiasme la critique, je n’ai qu’une envie : y plonger et voir si sur moi aussi opère la magie. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le sixième roman de la mauricienne Nathacha Appanah n’a pas volé les innombrables éloges qui ont accompagné la sortie de Tropique de la violence, d’ailleurs couronné par plusieurs prix littéraires.
Le récit s’ancre dans un territoire de France, un dont on ne parle jamais dans les actualités, un territoire presque totalement délaissé par la puissance publique : Mayotte. Mayotte et sa pauvreté épouvantable, sa jeunesse perdue qui pousse comme du chiendent, son absence d’horizon, sa violence explosive. Mais aussi Mayotte et ses plages de sable si fin qu’on dirait de la farine, Mayotte et son ciel bleu irréprochable, sa végétation luxuriante, sa chaleur, ses arbres majestueux (on entendre d’ailleurs régulièrement parler du flamboyant, un arbre magnifique aux feuilles rouge carmin).
Si Nathacha Appanah axe essentiellement son récit – comme l’indique le titre- sur la violence qui règne sur l’île, elle n’oublie pourtant pas d’évoquer, via des descriptions éblouissantes, la flore insulaire et la beauté naturelle de ces paysages de rêve. La trame s’articule autour de deux personnages centraux, deux adolescents qui se livrent une lutte sans merci dont on connaît, dès les premières pages, l’issue tragique.
C’est l’histoire de Moïse, le bien nommé, un gamin arrivé par la mer dans les bras d’une femme qui le confie aux bons soins d’une autre, Marie, qui devient de facto sa mère adoptive. Le garçon est un taiseux rêveur qui se complaît dans la simple compagnie de son chien et passe ses journées à lire, lire et relire L’enfant et la rivière (livre que j’ai très envie de lire depuis tant il semble poétique). Face à lui, on trouve Bruce, la brute épaisse, qui règne sans partage sur Gaza, le quartier chaud de la ville, et à qui tout le monde obéit au doigt et à l’œil.
C’est autour de leur relation que tourne cette œuvre, une relation complexe et ambiguë, faite de domination, de jalousie, de désir refoulé, de colère de cruauté. Au décès de sa mère, celui qu’on appelle désormais Mo va être contraint de se soumettre à Bruce, chef de gang, chef d’une mafia sans le sou mais prête à en découdre dans le sang et les (l)a(r)mes avec le moindre opposant. A sa botte, tous les gosses du coin, paumés, camés, oubliés de tous. A commencer de leurs propres parents : les adultes (hormis Marie, qui quitte tôt le récit) sont totalement absents, laissant la bride sur le cou à une jeunesse déboussolée, en mal d’autorité, de repères, de morale, de moyens et d’avenir.
Une jeunesse qui n’a que quelques pièces en poche pour s’acheter sa ration quotidienne d’Oasis, de clopes et de chimique, la (dévastatrice) drogue locale. Au sein de cet enfer, Mo essaie à peine de vivre, de se battre ou d’espérer. Il survit tout juste, un jour poussant l’autre au gré des humeurs de Bruce le tyran qui broie sa dignité et jusqu’à sa plus petite parcelle d’humanité. Il a pour lui, derniers gages de liberté, son silence, ses songes et son livre, comme seuls remparts contre l’angoisse et l’horreur de chaque jour.
A la manière du Joueurs d’échecs de Zweig qui tenait la folie à distance grâce au jeu, Moïse doit sa sauvegarde mentale à sa capacité à rêver, à s’extraire par la pensée de la fange dans laquelle il vit. Un passage m’a particulièrement bouleversée, par ce qu’il dit de l’oxygène que sont l’imaginaire et la rêverie, et par la plume ô combien superbe de Nathacha Appanah :
(…) j’ai levé mon visage vers le flamboyant. Le ciel, à travers les feuilles et les branches, était comme un tableau bleu, vert, marron, un tableau qui bougeait avec le vent ou c’était moi qui tanguais un peu peut-être. J’ai fermé les yeux. J’aurais voulu pouvoir voler, regarder ce foutu monde de haut, de très haut, être inatteignable, inattaquable, invincible, invisible. J’aurais aimé être un homme oiseau, non j’aurais aimé être un oiseau tout court et piailler ici et partout. J’ai imaginé mes os et mon corps rétrécir, mes pores s’ouvrir pour laisser sortir des plumes vertes du même vert que mon œil, j’ai senti ma cicatrice disparaître, mes yeux s’arrondir et devenir hypermobiles, mon visage s’allonger, ma bouche se transformer en un bec pointu, noir et luisant, mon cerveau se ramasser en un petit pois, mes souvenirs s’envoler en fumée, mes pattes décoller, mes ailes s’ouvrir et alors, je vole, je me pose sur la grande branche solide et épaisse du flamboyant. Je suis léger et puissant à la fois. Je chante. J’allume le soleil, je suis faiseur de pluies, je fais des merveilles.
Et merveilleux ce livre l’est, assurément.
Malgré sa noirceur et sa mélancolie, malgré l’atroce dureté de certains passages, malgré l’accablant sous-texte politique, Nathacha Appanah ne se départit jamais de sa bienveillante empathie, un regard dont elle rend compte avec une plume envoûtante et maîtrisée, qui entrelace l’oralité exotique de la langue mahoraise et un lyrisme qui emporte et charme comme une vague océanique.
Un livre terrible, cruel et poétique qui nous emmène loin, loin dans cet âpre territoire perdu de la République, loin dans la psyché de ses personnages poussés sur ce terreau violent, rendus fous par l’absence d’amour.
Tropique de la violence, mais aussi de la poésie et de l’espoir que les choses changent et que les consciences s’éveillent enfin.