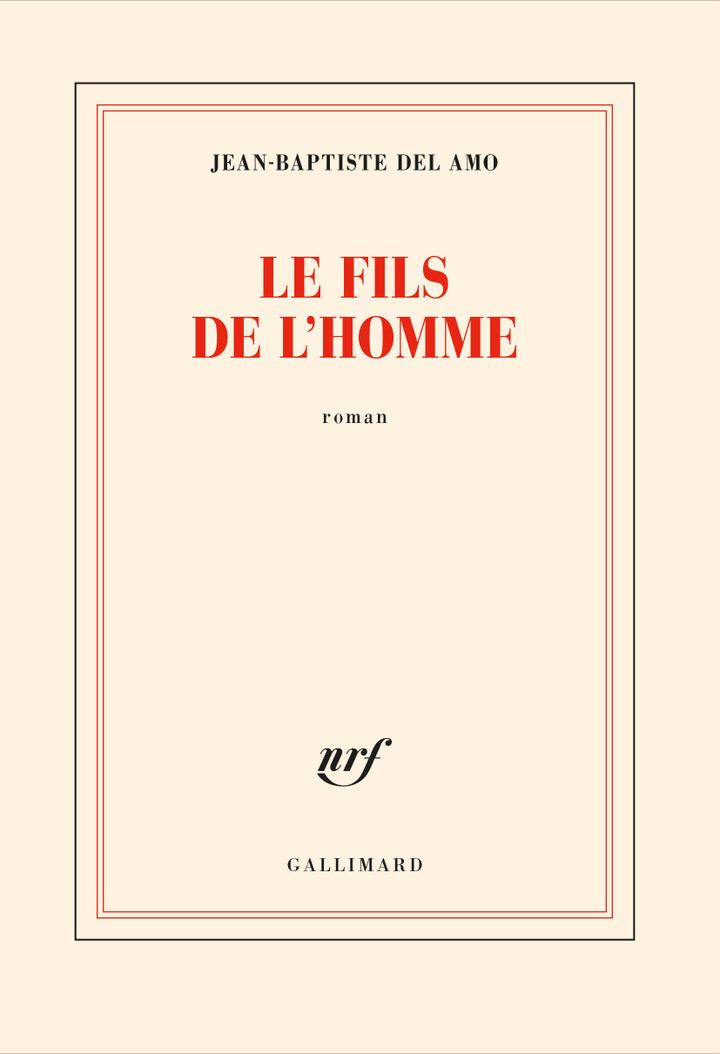Into the wild
Un uppercut que cette lecture dont j’émerge sonnée comme un boxeur après un KO. Le final m’a un peu laissée sur ma faim mais l’ensemble est absolument saisissant.
J’avais déjà beaucoup aimé « Une éducation libertine » dont je garde un vibrant et vivant souvenir de lecture- « Le fils de l’homme » me confirme que Jean-Baptiste Del Amo est une très grande voix littéraire.
Les 25 premières pages, « l’ouverture » comme on dirait d’un opéra (et ce roman en est un, cruel et poétique), nous le disent déjà suffisamment : quelle séquence que cette description au ras des peaux, du sang et des herbes, de cette tribu primitive, accaparée par la chasse d’un cerf ou la pêche d’un saumon.. La sauvagerie à l’état pur, à l’appui d’un style extrêmement littéraire, précis et très justement sophistiqué : voilà qui m’a laissée béate d’admiration. L’auteur semble vouloir placer son propos sous la tutelle de certains thèmes, que l’on verra différemment exposés par la suite (nature, isolement, survie, aimalisation de l’homme…)
Puis, nous entrons dans le cœur de l’intrigue contemporaine. Celle d’un père qui revient vers son ancienne compagne (la mère) et leur fils, un garçonnet de 9 ans. Le père a disparu pendant des année dans des circonstances troubles et il retrouve son ex toujours seule mais enceinte, une trahison qu’il ne digère pas.
Il ne se passe pas forcément grand chose mais Del Amo a l’art de nous hypnotiser par son regard cinématographique, sa plume qui scrute le moindre détail, la précision chirurgicale du moindre geste, comme si celui-ci recelait un mystère ou annonçait un drame. Nous lisons ce livre, de bout en bout, le souffle presque coupé, presque en apnée, dans l’attente d’une catastrophe. J’ai trouvé que c’était là une magie qu’on ne voyait pas souvent en littérature.
Alors que nous suivions la procession primitive au tout début, nous voilà avec le père, la mère et le fils à les suivre à travers la montagne dans laquelle ils s’enfoncent avec peine. Le père a décidé d’emmener les siens aux « Roches », un lieu où il a vécu avec son père dans d’étranges circonstances. Le lieu, atteint au terme d’un périple éreintant, n’est que ruines et décor spartiate. C’est là que les 3 vont vivre en huis-clos pendant tout le roman.
« Il n’y a pas pire qu’un homme blessé », confie un jour le père à son fils à qui il apprend le maniement des armes et à quel point il doit fuir l’amour à tout prix, qui toujours déçoit. Del Amo parvient avec brio à nous faire sentir la sauvagerie latente, la rage larvée, brute, du père, dont le lecteur se méfie autant que ceux qui l’entourent (quand il mange, sa manière de lécher son incisive). Nous sentons poindre, sourdre une menace mais impossible de dire comment elle se manifestera. L’auteur entretiendra le mystère jusqu’à la dernière ligne, au bout d’ultimes pages aussi haletantes que terrifiantes. Forêt de contes et vie recluse : des ressorts romanesques habituels mais utilisés avec poésie et brio par Del Amo.
La fin de l’été s’étire en une langueur hypnotique, nuits torpides durant lesquelles même la pierre des Roches exsude sa moiteur, journées accablée de soleil, aubes irréelles, nébuleuses, bientôt tranchées net par la lame du jour, crépuscules d’un rouge de forge s’effondrant l’instant d’après dans des ténèbres empourprées, des noirs de fusain.
La nature alentour, cette épaisse forêt si impeccablement exprimée par l’auteur, est ici un personnage à part entière, hostile bien souvent. Del Amo use (sans abuser) d’incroyables épithètes pour dire la variété de la faune et de la flore, des séquences qu’on dirait jaillies d’un manuel (littéraire !) de sciences naturelles. Le nombre de termes appris à cette lecture est fou (« barbastelles, Mérens.. »). Pour sûr, l’auteur s’est documenté. Il en fait une nature pleinement vivante, dont les humains ne parviennent pas (plus) à interpréter correctement les signes mais qui est omniprésente à chaque instant et dont il est sans cesse question. Le père se met en tête de réparer la ruine de son aïeul, de faire un potager mais il bute, il se heurte à des difficultés, Marlboro au bec, le corps las.
Sous-tend ce roman un propos social, sociologique sur la volonté de conquérir une terre à soi, même le moindre lopin, quand on est né manant.
Je pensais, à la lecture de la 4ème, que la folie allait véritablement le ronger et le roman prendre une (sanglante) tournure de thriller mais c’est de tragédie qu’il sera question, et mon dieu quelle horreur.
L’auteur fait des allers et retours temporels entre le présent dans les bois et le passé, qui explique peu à peu l’attitude du père et son histoire avec la mère. Le père se confie au fils (et le simple fait qu’ils ne portent pas de prénoms en fait des « types » universels) sur sa propre relation avec son géniteur, un type irascible et solitaire, peuplé de drames innombrables qui ont laissé d’inévitables traces chez son enfant. Del Amo ne s’appesantit jamais sur les émotions, les sentiments, il n’est pas là pour s’attacher à cela. Il reste un narrateur externe, qui ne se penche guère sur les états d’âme de ses personnages. Le regard se contente de décrire, notamment l’enfant et ses activités champêtres, les allées et venues des lumières et des saisons, l’apparition des couleurs et les noms des plantes, le bruit du vent ou encore l’enfant qui se rapproche d’un troupeau de chevaux sauvages :
Il les nomme et leur parle, de cette voix universelle, celle des enfants s’adressant aux bêtes.
On verrait aisément ce texte adapté au cinéma par un réalisateur talentueux de « cinéma de genre ». Il y a de quoi montrer cette atmosphère sombre et mélancolique, où planent des dangers dont on ignore la nature. Le père, qui aime vivre « dangereusement », qui s’ébroue « comme une bête », a des formules qui effraient, des comportements étranges, une attitude dont on ignore si elles sont, seront un péril pour son entourage ou non. Sans cesse, le roman joue sur une ligne de crête ténue, entre raison et folie. Pour lui, la trahison de la mère, dira-t-il à son fils, est « un coup de couteau asséné sans relâche », et de toute façon :
Un homme n’est jamais le même quoi qu’il advienne.
La dernière partie m’a terrorisée, jusqu’aux derniers mots, dans un final que j’aurais souhaité autre mais la volonté de l’auteur est souveraine. Je pensais clouer le père au pilori et en fait, au beau milieu des décombres, je lui trouve quelque chose de bouleversant.
Un livre sur la violence, le ressentiment, la douleur de vivre et la difficulté d’être quand on se sent rien depuis toujours, sur la volonté de survivre coûte que coûte néanmoins, un roman haletant d’une mélancolique noirceur mais gorgé d’une beauté et d’une poésie rares.
Chef d’œuvre.