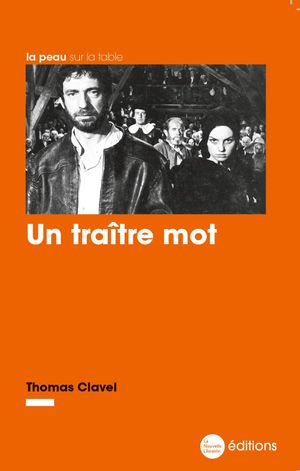Puni soit qui mal y parle
« Pas d’amalgames ! Le bienheureux syntagme avait vu le jour après l’attentat contre Charlie Hebdo. Puis il avait métastasé à l’intérieur du corps médiatique et faisait désormais partie de l’arsenal obligatoire de la nouvelle morale linguistique. »
On aurait envie de prendre le remarquable roman de Thomas Clavel pour une dystopie imaginative mais le réel talonne actuellement tellement la fiction que les situations présentées dans ce texte semblent à portée de réalisation.
Nous rencontrons Maxence, un jeune chercheur en littérature à l’université qui, un beau jour, excédé par une démarcheuse malhonnête au téléphone, va avoir une formule malheureuse et comparer ses techniques à celles employées par les « Roms » dans le métro… Ô rage, ô désespoir ! Car la France dépeinte par Thomas Clavel est alors celle d’un pays qui punit bien plus sévèrement les « crimes de parole » (via l’implacable loi AVE- Application du Vivre Ensemble), que les vrais délits criminels (qui bénéficient eux d’une clémence liée à « l’oppressisme » et au statut de « victime » des mis en cause….).
On voit bien, comme le dira un personnage, que tout passe par la voix, le son, l’oreille. Un jour, un prisonnier puni pour avoir refusé de parler se voit marteler des phrases bien-pensantes, des « gentils mots », à haute intensité, pendant des heures.
Quand il ressort, il a cette phrase à la fois terrible et lumineuse :
« On m’empoisonne… Lentement, jour après jour, par les oreilles… »
J’ai trouvé que cela résumait parfaitement la manipulation médiatique utilisée par la propagande officielle, qui en serait presque à vouloir punir les contrevenants en les faisant, comme dans ce roman, « réciter publiquement deux dizaines de Je suis Charlie et de Je suis non genré« .
N’était-ce pas un haut responsable nazi qui expliquait qu’il suffisait de répéter quelque chose pour le rendre vrai ?
Entre deux épisodes contemporains, Thomas Clavel intercale des chapitres se déroulant au Liban dans les années 60 puis un peu plus tard. Il y décrit un congrès universitaire scientifique et syncrétique « laissant entrer un jour serein, une lumière inaltérable » (quelle belle phrase) puis, à la fin, une séquence autour d’un étudiant venu se plaindre qu’un chrétien enseigne le polythéisme à des élèves musulmans. Thomas Clavel livre ici un nouvel exemple de cette dérive obscurantiste totalitaire, qui prend différentes formes selon les lieux, qu’il s’agisse de l’Orient ou de l’Occident.
« Cette solution, c’était la guerre, la guerre des minorités, des citoyens, la guerre de tous contre tous, la guerre qui devait arranger quelques-uns, tout là-haut. »
Par un enchaînement de circonstances malheureuses et une parodie de procès expédiée, Maxence se retrouve donc prisonnier, ou plutôt « pénitent », ainsi que sont décrits les renégats du vivrensemble accusés de propager « la haine ». La prison ressemble à une sorte de centre de redressement idéologique où les « coupables » se voient asséner ad nauseam des cours censés les remettre dans le droit chemin de la pensée autorisée et bienveillante.
Jouxtant le pénitencier des êtres lexicalement subversifs, la prison des vrais criminels offre, en contraste, beaucoup plus de libertés et de possibilités (smartphones, promenades…). Nous sommes bien ici dans une sorte de rencontre entre Kafka (l’interrogatoire que subit Maxence au début fait évidemment penser au « Procès ») et Orwell qui, dans son « 1984 », raconte comme les mots ont été réduits au strict minimum, afin que la pensée se délite à son tour. Ici, c’est « enfreindre la langue » qui constitue l’un des pires crimes et, philosophiquement parlant, il y aurait tant à dire sur cette « simple » idée….
« Préférez toujours la belle expression ‘choix personnel’ au vilain mot ‘Nature’ ! »
Ce qu’on note également dès les premières lignes, c’est la belle fluidité teintée de classicisme du style de Thomas Clavel, enseignant à la ville.
Le roman, très drôle et dramatique à la fois, est émaillé de références littéraires, poétiques et de citations latines du meilleur goût, qui en disent long sur l’élégante culture de l’auteur et comme elle nourrit sa prose romanesque. L’auteur va d’ailleurs, armé de son corpus, placer son Maxence à la tête d’une tentative de mutinerie littéraire au sein de la prison. En effet, l’idée de l’enseignant, c’est de donner des cours « d’impiété verbale », de désintoxiquer le lexique bien-pensant en redonnant aux mots galvaudés par la tyrannie leur richesse littéraire. Il s’agit de remotiver le signifiant en poétisant le signifié. Ainsi, « amalgame », « nauséabond », « race », « minorité » et « stigmatisation » retrouvent-ils toute leur noblesse quand on fait un détour par Baudelaire, Rimbaud, Malraux ou Mallarmé. Heureusement, encore alors, « la pensée restait un territoire inviolable ». Mais la question est : jusqu’à quand ?
« Une minorité comporte encore une majorité d’imbéciles » (Malraux)
La littérature comme bouclier, comme planche de salut, comme « défense et illustration » de la langue, n’est pas une idée neuve mais elle est traitée avec un tel esprit, un tel humour, une culture si singulière que le lecteur ne peut qu’être pleinement séduit.
« Rien ne demeurera sans être proféré », écrivait Mallarmé et ce roman est la preuve qu’il est indispensable et vital de revivifier la langue quand elle est utilisée à des fins idéologiques destructrices, d’en revenir aux grands auteurs, aux poètes et penseurs majeurs. De repenser sa propre langue pour s’en faire à nouveau maître, ne plus en être dépossédé par quelque puissance nuisible extérieure à soi.
« Désigne-moi ma part si tant est qu’elle existe, ma part justifiée dans le destin commun au centre duquel ma singularité fait tache mais retient l’amalgame ! » écrivit René Char (mon idole), une phrase que (incroyablement) j’ignorais (merci Thomas !) : comment ne pas aimer un auteur qui cite ce poète et campe un personnage qui déclame des « Amor fati » et « In cauda venenum » quand la fatalité s’abat sur lui ? (voilà qui me rappelle mon ami Emmanuel Venet!)
Avec « Un traître mot », Thomas Clavel se pose en romancier brillant soulevant des questions contemporaines centrales, invitant à une fructueuse réflexion, avec un esprit plein de poésie, d’intelligence et d’humour : n’est-ce point là le rôle du romancier ?
Adoré, à tous points de vue.