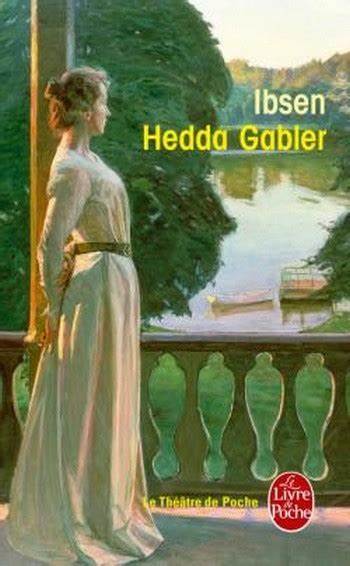Hedda elle l’a
Une décennie après « Une maison de poupée », Ibsen peint à nouveau une bourgeoise oisive qui va finir par péter un câble (c’est le moins qu’on puisse dire) et qui n’aura cessé d’étaler son cynisme et sa perfidie tout au long de la pièce.
Qu’on ne vienne pas me dire que la littérature « invisibilise » le beau sexe ou leur fait tenir des rôles de potiche : il faut voir quels portraits féminins surpuissants brosse le dramaturge norvégien et comme les hommes sont décrits comme veules, passifs et soumis (les femmes en général, surtout les héroïnes centrales, les méprisent et ne s’en cachent pas).
La force de caractère d’Hedda, sa force phallique (ses revolvers en sont le symbole), son méchant franc-parler qui n’hésite pas à blesser, son insensibilité sont a priori des traits que l’on prête habituellement aux hommes. Mais Ibsen n’est jamais là où on l’attend et son théâtre m’apparaît d’une remarquable modernité, à la fois par la vivacité de sa forme que par la pertinence des thèmes qu’il aborde (les finances, la création, la jalousie, l’ennui…)
J’ai préféré « Une maison de poupée » (le personnage de Nora est plus attachant) j’ai lu « Hedda Gabler » sans déplaisir et avec admiration, même si la fin arrive un peu trop abruptement à mon goût et que j’aurais vraiment aimé connaître le contenu du manuscrit de Lovborg sur la « civilisation de l’avenir ».
Pour une fois dans ma vie, je veux tenir le destin d’un homme entre mes mains.