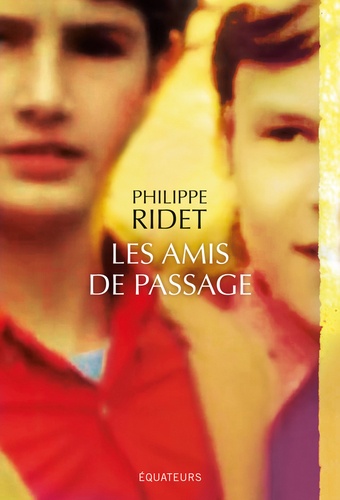L’ami retrouvé
À la suite de son précédent roman (le remarquable « Ce crime est à moi ») Philippe Ridet offre avec ce nouveau texte une riche et pertinente chronique de la France provinciale autant qu’un développement romanesque et sensible autour de la mémoire, du temps qui passe et, ici, de l’amitié. Une prose que j’ai souvent reçue comme un condensé d’esprit français tel qu’il subsistait encore dans certains petits villages- un esprit aujourd’hui disparu dans les méandres de la modernité :
Le café débordait alors d’une joie simple et chaleureuse.
« Les amis de passage » nous fait rencontrer Zoran, un immigré croate que le narrateur, Ponthus, a croisé durant une année, à l’adolescence, dans leur petite ville de province. Le second est ensuite « monté » à la capitale, tandis que le premier s’est enraciné où il avait toujours vécu. Se dessinent alors des trajectoires de vie parallèles, que Ponthus va tenter de remonter, à l’occasion d’un retour au bercail.
La voix et le regard de Ponthus ressemblent beaucoup à ceux de « Ce crime est à moi »: même regard un peu désabusé et nostalgique sur les êtres et les choses, mêmes constats amers face aux irrémédiables mutations de la ville moderne, même gêne face aux sentiments et aux mondanités, même goût pour la solitude. Un personnage à mi-chemin entre Proust et Houellebecq, en somme.
À travers la vie de cet « ami » (« ce mot qu’il ne voulait pas prononcer »), peu connu mais pourtant indélébile à sa mémoire, c’est son propre paysage mémoriel que reconstitue le narrateur, sa propre vie dont il remonte les sentiers anciens. Exactement comme dans « Ce crime est à moi », ce qui dessine là les contours d’une obsession d’écrivain chez Philippe Ridet.
La ville (qui « partout le suivait ») est ici à nouveau un personnage à part entière, elle est l’occasion de profondes considérations sociales et socio-culturelles, tout comme elle suscite des réflexions sur l’opposition entre Paris et la province. Avec toujours, en filigrane, la question de l’appartenance, des racines, de la trace que laissent les lieux (comme les amis !) de passage en nous.
Les lieux forgeaient un destin à l’égal des origines sociales. (…) Parce qu’ils parlaient peu, les Provinciaux pensaient juste.
Le « retour » (ou plutôt l’irruption) de Zoran, personnage du passé en province, dans la vie présente et parisienne de Ponthus fait surgir chez ce dernier une kyrielle de réminiscences, « copeaux de mémoire » et autres fragments de « temps retrouvé » arrachés aux jours qui filent. Remontée imposée de lambeaux de souvenirs vécue comme une forme de régression :
[Zoran] appartenait à un lieu, une époque dont Ponthus achevait de se défaire. (…) [Ils étaient] l’un pour l’autre un fanal dans une époque lointaine.
Les séquences de retrouvailles entre Ponthus et Zoran sont très réussies en ce qu’elles parviennent à faire sentir avec une sincérité redoutable la gêne entre les personnages, le décalage irrémédiable qui les sépare et cette confusion qui naît entre ceux qui se savent de mondes différents, mais néanmoins obscurément liés par un passé lointain. La vie minuscule et tragique de Zoran m’a parue pathétique, glauque et touchante à la fois, à l’instar de ces funérailles à la fin qui jettent une autre lumière sur le personnage.
Un livre mélancolique et beau sur l’éphémère de nos existences, le caractère passager de nos attachements, et celui infiniment fragile de nos vies qui ne laisseront que peu d’empreintes durables chez quiconque. Un roman émouvant et d’une grande finesse sur « les filaments de mémoire » qui résistent au rouleau-compresseur des années et forment le poignant fond d’écran, la mosaïque unique de nos destinées.