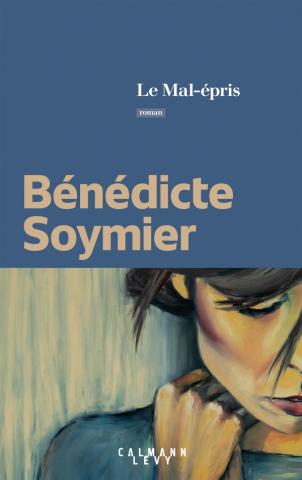Requiem pour un mâl(e)otru
On dit souvent que la première phrase décide de tout le reste, qu’elle donne le la du récit, résume parfois la totalité, la tonalité d’un roman. Celle du premier roman de Bénédicte Soymier, le superbement intitulé « Le Mal-épris », donne le ton d’entrée :
« Paul n’est pas beau. »
Cette affirmation sera le fil rouge de l’histoire. Ce constat conditionne toute la vie du « héros » de ces 245 pages. Juste avant, un bref prologue ancre le roman (en est-il un d’ailleurs ?) dans le réel tout en créant savamment l’attente chez le lecteur : « Je ne brode pas, c’est ton récit. Et rien ne t’excuse. » Je dois avouer qu’en bonne lectrice de polars et amatrice de faits divers, je m’attendais à une sorte de Faites entrer l’accusé version papier, m’en pourléchais les babines par avance.
Je me méprenais pourtant sur le tour qu’allait prendre cette histoire, que je rapprocherais davantage du cinéma des frères Dardenne ou de Ken Loach, une radiographie sociale radicale et une plongée dans l’univers chaotique des petites gens que la vie n’épargne guère. Le regard de Bénédicte Soymier sur ses personnages, tour à tour attachants, insupportables, méprisables ou bouleversants, est bien celui, plein d’empathie et de douceur, de l’infirmière qu’elle est dans le civil.
Toutefois, cette compassion n’exclut pas le ferme jugement, l’accusation aussi, même si bien souvent ici, les coupables sont également (et avant tout) des victimes. C’est toute la difficulté de cette entreprise romanesque qui met en scène des personnages aux prises avec leurs ambivalences et qui suscitent chez le lecteur autant l’envie de les gifler que de les consoler.
Nous rencontrons donc Paul, médiocre employé des postes au physique ingrat, solitaire, jaloux des « gens beaux », aigre et amer, issu d’une histoire familiale compliquée et pour qui le quotidien n’est qu’un vaste et monotone chemin de croix. Seule sa sœur Emilie, dont il est très proche depuis leur terrible enfance partagée, égaie ses jours tristes. (Je n’ai pas pu m’empêcher de songer à ma lecture précédente, celle du somptueux Le goût des femmes laides de Richard Millet, qui traite aussi de la laideur d’un personnage lui aussi extrêmement proche de sa sœur…)
Chaque journée se ressemble, ne souffre jamais un imprévu, se déroule toujours entre ressassements des échecs passés et absence d’horizon. Jusqu’à l’irruption de l’élément perturbateur, celle de la jeune Mylène, la voisine de palier, qui devient l’obsession de Paul. Son attitude voyeuriste, maladive, traquant, épiant et notant ses moindres faits, gestes, allées et venues, sentaient pour moi son psychopathe bon teint. Jugez plutôt :
« Paul s’est acheté un petit carnet bleu sur lequel il consigne ses départs, ses retours, ses rencontres, les mots qu’elle échange avec la voisine du dessus, ses tenues, ses coiffures. Il écrit ce qu’il aime et ce qu’il déteste, comme ses chaussures noires fermées par une boucle aux talons bien trop hauts pour une femme respectable. »
(On est d’accord, hein ? On est vraiment dans l’ambiance Les Nuits avec mon ennemi…) D’autant qu’il y a cette voix en italique, dont on ne sait si elle émane de la conscience du personnage ou d’une sorte de narrateur omniscient (« Mais c’est plus fort que tout, n’est-ce pas, Paul ? ») et qui semble signer le divorce intérieur du personnage.
Etonnamment, Paul va réussir à tisser un lien avec cette Mylène, mais sa propre incapacité relationnelle, sa difficulté à juguler ses pulsions, auront raison de cette histoire. Paul est comme un enfant sauvage, un jeune animal non apprivoisé, brut et brutal, coupable de ne pas s’empêcher, mais victime de n’avoir pas appris, pas su aimer. Le Mal-épris (titre lacanien qu’on peut également entendre comme Le Mâle est pris (au piège) ou Le Mal est pris comme un pli qui est pris) aurait pu s’appeler Le Mal-aimé mais c’eût été moins singulier.
On notera la majuscule à Mal qui fait signe du côté de l’allégorie : Paul est le cas d’école de son mal, une sorte de figure de proue négative du trouble dont il est victime. Malgré la noirceur et la douleur de (presque) chaque page, malgré l’incompréhension qui sépare inévitablement les êtres, accusant les autres de leurs propres turpitudes, Bénédicte Soymier nous dit aussi à quel point l’Homme est une machine à espérer contre vents et marées, à se remettre debout une fois démoli. A quel point aussi l’être humain vendrait son âme pour quelques miettes d’amour, même empoisonnées. Certaines réflexions sont d’une grande beauté :
L’amour s’arrime au respect des idées, des couleurs et des différences. Il grandit sur l’envie d’être deux, semblables et contrastés, sans violence et sans force, juste posé sur l’estime parce qu’on s’éprend sans comprendre, des cellules à l’esprit, conquis par stupeur ; une alchimie inexpliquée. Peut-être une odeur. Ou un sourire. Un truc qui retourne. Les sentiments.
Sans révéler la teneur exacte du roman et des événements surprenants qui vont s’y dérouler, nous dirons que Bénédicte Soymier nous dépeint le portrait d’un homme en souffrance, dont la haine de soi a des conséquences dramatiques sur les relations qu’il construit tant bien que mal. Qui fait signe du côté de l’enfance douloureuse, de la filiation qui pèse, qu’on exècre mais qu’on subit tout de même.
Sommes-nous voués à reproduire les erreurs et les errements de nos parents ? Peut-on changer ? Voilà notamment les questions que nous adresse ce premier roman poignant qui contourne tous les écueils qu’on aurait pu craindre avec un tel thème, émouvant sans pathos, touchant sans complaisance, toujours juste avec chacun des personnages. Des questions qui ne concernent pas exclusivement le (anti) héros de cette histoire, mais qui ricochent aussi sur le deuxième personnage féminin, celui d’Angélique (prénom prédestiné au sacerdoce…), la collègue de Paul avec qui l’espoir d’une histoire d’amour renaît. Mais « chassez le naturel, il revient au galop » et les bonnes résolutions sont bien vite pulvérisées par l’instant à chaud.
Maman solo abonnée aux hommes qu’elle ferait mieux de fuir, Angélique incarne aussi toutes les ambivalences et les paradoxes des femmes, se voulant à la fois objets assumés du désir et subissant les conséquences de cette assertion féministe. Bénédicte Soymier dit très bien les contradictions féminines, la versatilité des humeurs du beau sexe et ses tergiversations, le sentiment d’être une femme belle et forte et l’instant d’après, pour un regard, une moins que rien, une traînée. L’infirmière qu’est la romancière sait aussi comme se cache aussi souvent dans le cœur féminin l’envie maternelle de sauver, de soigner, de consoler : aussi Angélique a-t-elle (presque) toujours un pardon à offrir à celui qui la blesse. C’est sa grandeur et sa faiblesse. Le dénouement nous offre toutefois une trouée d’espérance dans la mélasse du malheur, comme un coup de pied salutaire donné au fond une fois qu’on l’a touché, une nouvelle naissance.
Roman sur ces hommes que les femmes rendent fous, sur ces femmes au cœur (trop) tendre, sur le décalage des attentes sentimentales, le poids de l’enfance, les conséquences du désamour, le regard d’autrui et la force qu’il faut déployer pour ne pas en souffrir, Le Mal-épris est un premier roman social haletant, proche du documentaire, porté par une plume fine, rythmique et puissante qui parvient à doser avec brio compassion et intransigeance.