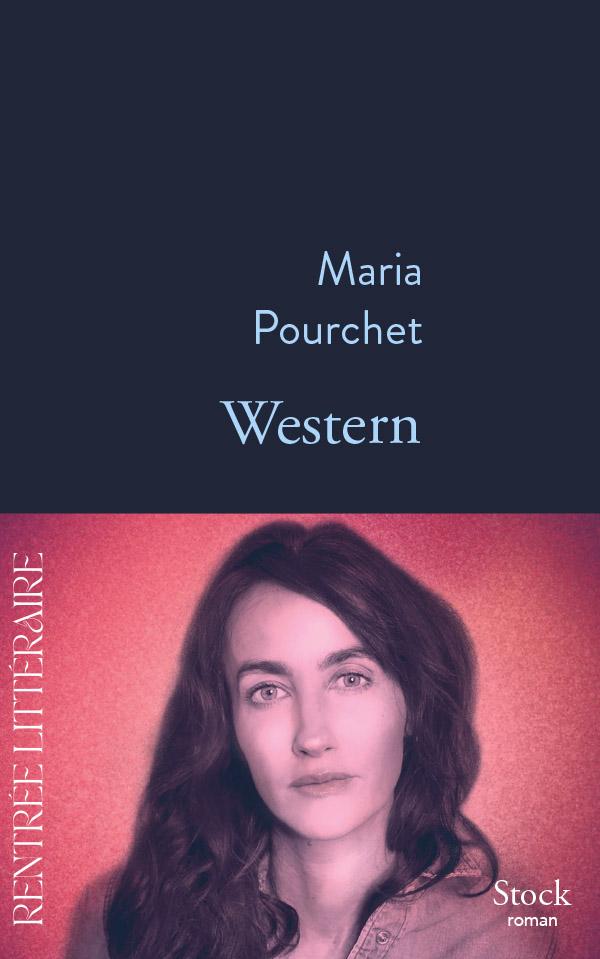Le mâle aimant
Autant je n’avais pas du tout aimé son texte précédent (« Feu »), autant j’ai adoré ce « Western » qui vient de valoir à Maria Pourchet le Prix de Flore.
Le titre sert de fil rouge (un brin artificiel, même si les passages concernés sont joliment écrits) à ce roman qui s’articule également autour de la figure de « Don Juan » de Molière. Il s’agit de brosser un tableau des manières de désirer, de séduire et d’aimer des mâles occidentaux (mais pas que) (« western » signifiant « occidental »), à l’appui de la figure du cavalier solitaire et de « Fragments d’un discours amoureux » de Barthes (une Bible pour moi).
Tout peut mentir, sauf la voix.
Soient donc, pour servir la (brillante) démonstration de ce (très intelligent) roman à thèse, Alexis Zagner, célèbre comédien qui use et abuse des charmes de sa gloire pour lever des minettes, et Aurore, une mère de 45 ans chargée d’un « bullshit job » en télétravail. J’ai craint, à la lecture des premières pages, de retomber, comme dans « Feu », sur un roman sur les pauvres mœurs désincarnées du triste monde du tertiaire parisien. Heureusement, très vite, Aurore atterrit dans le salvateur département du Lot (que j’aime d’amour), dans la maison de feue sa mère. On note au départ la même sécheresse sentimentale, écriture blanche et clinique, dénuée d’émotions, que dans le roman précédent. Mais, peu à peu, au fil d’un récit à la 3ème personne, le personnage va baisser la garde, se livrer, s’ouvrir et enfin toucher le lecteur par ses fragilités enfin assumées.
Dans les westerns, on recommence. On est ce que l’on espère, ce que l’on trouve, pas ce qu’on a fait. Le genre entier repose sur le solide imaginaire qu’aller à l’ouest, c’est aller à zéro.
Alexis et Aurore se rencontrent sur le Causse du Lot : il croit pouvoir se réfugier dans la maison que lui a laissée Sabine, la mère d’Aurore, sans savoir que sa fille est venue elle aussi y chercher la paix qu’elle cherchait. Tous deux (se) fuient pour des raisons différentes : elle en a soupé de l’amour et des hommes et veut « un lieu à soi » pour écrire ; il cherche à échapper à un épisode médiatique qui n’en est pourtant alors qu’à ses prémices.
Rester telle une bougie auprès d’un homme qui la soufflera, c’est sûr, elle ne veut plus.
Maria Pourchet, en plus de nous offrir une remarquable dissertation sur les mœurs amoureuses masculines, sur les « mensonges romantiques » (pour citer René Girard) qu’ils servent aux femmes pour les ravir et les illusions qui en découlent chez chacun, traite également avec pertinence du fonctionnement des médias qui répond à la règle des trois L : « lécher, lâcher, lyncher ».
À la faveur du dénouement tragique d’une énième aventure d’Alexis, celui qui hier était porté aux nues par une presse qui saluait la grandeur de son geste féministe (abandonner son rôle de Don Juan pour l’offrir à sa partenaire), va se retrouver alors cloué au pilori et chassé par la société tout entière, jamais avare d’une nouvelle proie à condamner.
Le risque est moindre à vivre dès lors qu’on en tire un chant.
Mais le cœur du livre n’est pas là. Il s’agit pour l’auteur de comprendre et d’exprimer ce qui préside aux attachements, à l’obsession amoureuse, ce qui motive véritablement le discours amoureux. Non sans une bonne dose d’humour et d’ironie mordante qui m’a fait sourire plus d’une fois. C’est que l’auteur installe un singulier dispositif narratif en se plaçant en surplomb de ses personnages (tel un metteur en scène), narrateur omniscient qui commente, ajuste, ironise, s’offusque, donne tort ou raison, qui à l’un, qui à l’autre.
C’est d’ailleurs toute la justesse de ce roman de ne porter aucun jugement définitif sur l’un ou l’autre sexe. J’ai particulièrement goûté cette absence de manichéisme qui donne toute sa vérité, sa sincérité à « Western ».
Maria Pourchet prend un malin plaisir à emmener son duo sur les routes dont ils voulaient justement s’écarter. Alexis se croyait tout-puissant dans son désir, mais voilà que « la statue du Commandeur est une gamine ». Aurore ne voulait plus entendre parler d’amour mais elle finit finalement par regarder sa vérité (et celle de toutes les femmes) en face :
Une romantique pathologique. Une qui ne voulait plus d’histoires, tu parles. Ça dépend laquelle.
L’auteur joue, avec beaucoup de dérision, sur la langue sentimentale, les poncifs et les effusions romantiques du langage qu’on emploie, version tragique. L’idée est de « détruire l’illusion du pacifisme du discours amoureux ». Comme dirait Juliette Armanet : « À la guerre comme à l’amour ».
« Adieu », on ne dit pas « adieu » dans la vraie vie. C’est romanesque, c’est bon signe. (…) Autrement dit « je t’aime » est un chaton ceinturé d’explosifs qu’on prend dans ses bras et boum.
Il naît de ces pages une démolition massive des préjugés sur le discours de l’amour à travers sa dissection clinique, administrative. Les passages qui reviennent sur les messages d’Alexis à la jeune Chloé pour la séduire sont particulièrement savoureux, qui décortiquent et comptabilisent froidement figures de style et champs lexicaux qu’il a fallu employer pour ferrer sa proie.
Le discours remplace, le discours fantomatise l’amour et vampirise le sujet.
J’ai été frappée par la justesse de ces passages où l’on comprend que l’homme a utilisé, pour séduire des femmes différentes (épouse comprise) les mêmes formules et tournures, qui révèlent « la reproductibilité mécanique » d’un discours que chacun imagine pourtant unique et adressé à soi seul. « Western » apparaît alors comme une entreprise de destruction massive du dire sentimental.
Et pourtant.
Et pourtant la fin dit exactement l’inverse. Que l’amour, le sentiment, reviennent, renaissent toujours. Toujours repousse, ici ou là, cet enfant de Bohême. Qu’on le veuille ou non, qu’on ait compris l’envers du jeu et du décor, ou non. C’est plus fort que nous, voilà tout. Humains, trop humains….
Entre-temps, Aurore aura exprimé sa vérité, son secret, celui qui met la force de l’homme face à la seule parole de la femme, bien impuissante alors. Elle aura intégré « la délirante certitude du genre qui ruinait [son] destin », mais aussi que « les hommes [sont] fatigués du rêve que les femmes leur font porter. »
Balle au centre.
Un texte qui déracine les préjugés, masculins comme féminins, autant que les illusions. Un texte qui secoue, fait réfléchir, bouleverse parfois codes et places traditionnellement attribuées.
Si le western est un genre, c’est le féminin. Il articule en un seul trajet l’idée du destin et l’idée du tragique de la condition humaine, à celle de la plus fascinante liberté. C’est quoi, tout ça en une seule forme, sinon une femme.
L’idée, c’est désormais d’user de cette liberté (d’aimer, de s’attacher, de partir ou de revenir) en toute conscience et connaissance de cause. D’agir sciemment, non d’être agie par des forces dont on demeure le jouet. D’être soi-même en surplomb de soi, son propre commentateur lucide. D’assumer ses travers, avec humour. Le retour du « je » dans les dernières pages dit bien cette réappropriation de la femme sur son destin.
Et puis merde, je vais encore dire je t’aime avant tout le monde.
Et puis, dans la tout dernière partie, ces grandes vérités sur l’histoire qu’on se fait de soi, le mythe qu’on se raconte, celui qu’on cherche. Qui m’a fait penser à Deleuze citant Proust, « Je n’aime pas une femme mais un paysage » :
Davantage qu’un amour, elle cherche un récit. (…) une quête démesurée, insatisfaite, qui ne découvre ce qu’elle cherche, l’amour et la tranquillité, qu’au bord de la démence.
Avec le retour final sur Barthes, qui définissait l’amoureux comme « celui qui attend » (« elle était amoureuse, oui, puisqu’elle attendait de nouveau. ») En somme, « Western » nous dit le perpétuel retour, renouveau de l’amour- et c’est sans doute très bien comme ça.
La tirade finale et impromptue d’Alexis m’a saisie par sa pleine sincérité, ce regard sans fard sur soi, enfin débarrassé des illusions qu’il se servait lui-même. Avec la conscience aiguë, énoncée par James Joyce dans Ulysse, de l’inoubliable « Love loves to love love » :
Je suis la chambre d’échos de mes propres serments, menteurs et usés. (…) Je suis Don Juan qui répète avec méthode le désordre de sa chair et qui les yeux fermés relance la contagion amoureuse comme une grippe saisonnière. (…) Je répétais l’amour comme je répétais au théâtre. Pour en vivre. Comme vous, comme toi qui regardes ailleurs.
Une démonstration romanesque éclatante que, malgré tous ses écueils, ses tragédies, ses naufrages et ses mensonges, l’amour ne cessera jamais d’être éternellement le cœur battant et l’unique obsession de nos vies.
Magnifique.