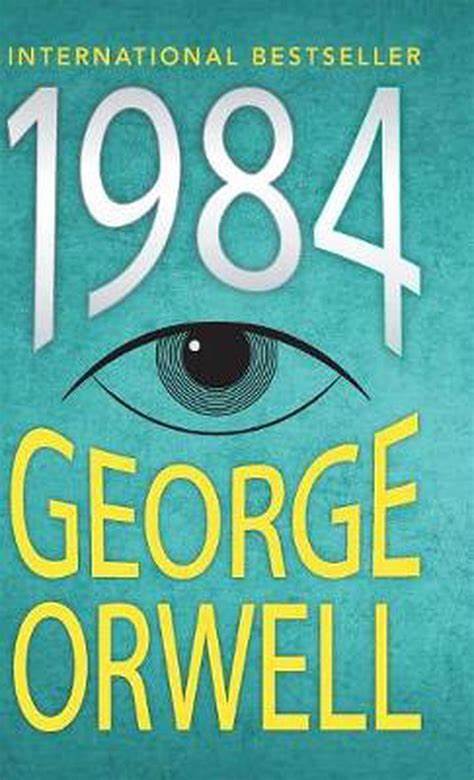« Toi qui entres ici, abandonne toute espérance »
[Qu’il me soit permis d’employer en titre un extrait de L’Enfer de Dante Alighieri, on ne peut plus adapté à cette œuvre.] J’ai donc refermé hier, sur la plage de Balòs (dans le contexte exactement inverse du livre), la dystopie littéraire la plus célèbre du XXème siècle.
J’en suis sortie passablement déprimée.
Voilà un livre d’une noirceur absolue duquel n’émerge nulle once d’espoir. Certains passages m’ont tellement écœurée, douloureusement, que j’en ai poussé des cris sur ma chaise longue – notamment lorsque Winston arrive dans la chambre 201 et y est confronté à son pire cauchemar. 1984 est peut-être la seule œuvre qui vous donne envie d’être un pauvre prolétaire aux prises avec les vices de sa classe.
Difficile de résumer les différentes thèses exposées dans ce bouquin culte qui brosse le terrifiant tableau des possibles dérives d’un régime totalitaire à la puissance aveugle. Un régime qui mène des guerres aussi absconses qu’iniques auxquelles personne ne comprend rien (tiens, tiens..), qui modifie les livres, l’actualité, l’Histoire et le passé pour les arranger à son avantage…(hmm..)
L’obsession de la théorie orwellienne est pour moi celui du contrôle absolu des populations, via l’invasion des télécrans qui scrutent partout et en permanence le moindre de vos gestes, appuyée par un système de délation bien huilé (dans lequel les enfants dénoncent leurs propres parents à la fameuse Police de la Pensée). Tout individu sortant un tant soit peu du cadre imposé par le Parti sera vaporisé.
Les règles sont simples : marche ou crève. Orwell engage également une réflexion profonde sur le langage (la fameuse novlangue devenue néoparler dans la nouvelle traduction) : en le simplifiant à l’extrême via ce dictionnaire débile, le Parti de 1984 entend réduire d’autant le champ et la qualité de la pensée de ses administrés/esclaves. Une masse abrutie étant plus malléable qu’une masse qui pense.
Cela m’a conduite à deux idées : dans notre société, nous avons deux tendances quand il s’agit de la langue et des mots. Soit une inutile et immonde complexification du langage – dont le meilleur exemple reste le référentiel bondissant des néo-pédagogues pour désigner un simple ballon (que les parents qui me lisent détaillent les livrets de compétence de leurs enfants pour comprendre ces imbécilités langagières abusives) ; soit une simplification tout aussi abusive de la langue – qu’on se rappelle le débat récent autour des projets de l’Académie de supprimer l’accent circonflexe ou les doubles consonnes dans certains mots.
Orwell était, en 1948 et à plus d’un titre, un sacré visionnaire. La question de la liberté est bien évidemment la clef de voûte de cet effroyable 1984. Quand toute la société est réduite à une forme d’esclavage, reste aux individus – du moins à ceux qui le peuvent encore – à s’accrocher aux derniers bastions de leur conscience individuelle : leur liberté de penser et d’aimer. C’est ce avec quoi lutte Winston tout au long du livre, ce qu’il défendra corps et âme jusqu’au bout, conscient que siègent là les vestiges de son humanité.
J’ai été particulièrement choquée par la cruauté généralisée, la déshumanisation des êtres (très souvent comparés physiquement à des animaux), l’atmosphère de paranoïa absolue et la duplicité des personnages qui évoluent dans ce monde si aveuglément noir. Le lecteur sort de cette histoire le cœur lourd en espérant ne jamais voir advenir cette ère obscure. Et pourtant, on se prend à réfléchir : notre société pourrait-elle déguiser avec hypocrisie des fonctionnements tels que le décrit 1984 ? Unique oasis de clarté – provisoire !- dans cet océan de ténèbres, l’histoire d’amour entre Winston et Julia que j’ai trouvée très émouvante (même si je n’ai pas forcément saisi ce qui se passait à la fin…)
Œuvre à thèses et thématiques multiples, impossible à résumer en quelques lignes, 1984 est pour moi une œuvre cathartique qui invite à la vigilance quant aux dérives et délires de tout pouvoir en place. En nous tendant cet épouvantable miroir, Orwell semble nous inviter à jouir pleinement des libertés dont nous disposons (encore). A chérir notre chance d’aimer qui nous voulons, de nous déplacer à notre guise, d’écrire et de dire ce que bon nous semble (encore que…), de manger et de boire ce qui nous chante – et même d’enfreindre la loi si on le souhaite. De profiter pleinement du confort, de la beauté du monde et des gens, des beaux arts et de la gastronomie : de tout ce qui, en somme, donne sa saveur, sa douceur, sa grâce et sa grandeur à l’existence humaine.
Un livre d’une cruauté et d’un pessimisme exceptionnels qui doit nous engager à en prendre, en toute liberté, le total contre-pied. (Tant qu’il est encore temps ?)