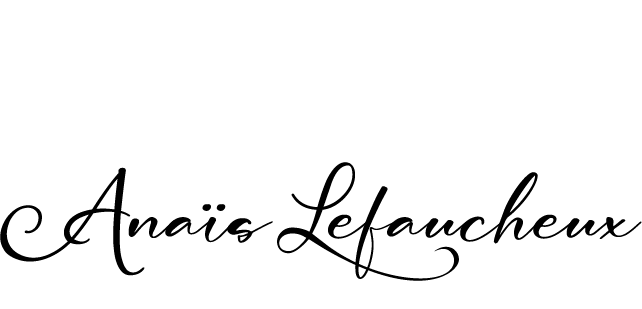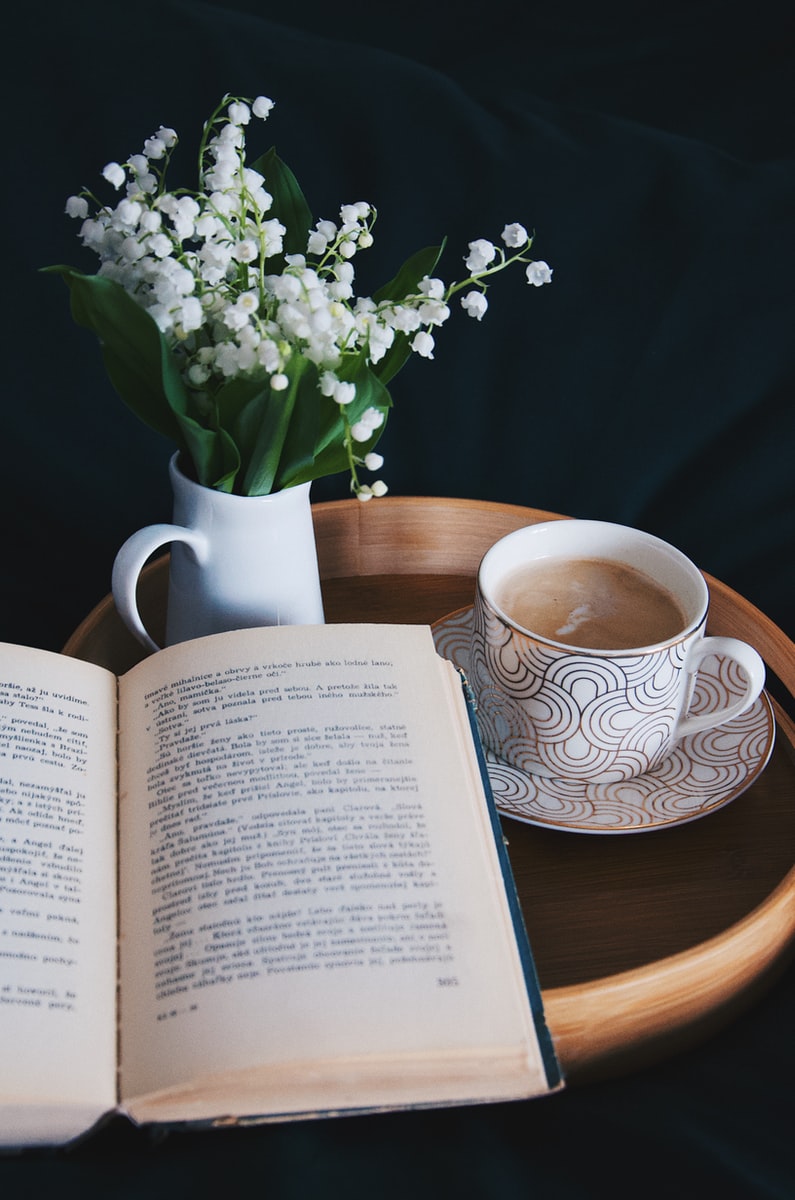Trois souvenirs de ma jeunesse
Je me permets d’emprunter le titre du (magnifique) film d’Arnaud Desplechin pour cette chronique car il m’apparaît que le romancier Philippe Ridet a bien des points communs avec le sensible cinéaste.
Même tendre manière de capturer l’éphémère, de croquer les contours de la jeunesse, même délicatesse dans l’expression d’une sorte de nostalgie heureuse, de mélancolie joyeuse, sans pesanteur, toujours avec grâce et profondeur.
C’est le troisième texte que je lis de Phillipe Ridet et, si j’avais déjà beaucoup aimé les précédents, celui-ci m’a peut-être encore plus émue, plus serré le cœur encore que les autres. Car il est question de ces fêtes post-adolescentes, de ces excès nocturnes, de ces bandes de potes qu’on croit éternelles, de ces danses enfiévrées et autres discussions éthyliques jusqu’à l’aube, de ces intrigues amoureuses qui font le sel de cet âge et de cet avenir encore flou qui va bientôt décider pour nous.
Certains passages mettent les larmes aux yeux avec une simplicité désarmante :
Un jour, sûrement, quand la vie les aurait séparés, ils se rappelleraient de cet après-midi sans consistance où le bonheur d’être ensemble primait sur tout le reste.
La magie du style si élégant et émouvant, si juste et troublant de Philippe Ridet, c’est de parvenir à nous rendre familiers des étrangers, connues des scènes où nous n’étions pas conviés et que pourtant, nous reconnaissons. Ce pavillon de Jean-Denis, déserté par les parents et immédiatement investi par les (nombreux) amis du soir au matin, les cadavres de bouteilles, le souk partout, les cendriers pleins, le couchage anarchique, les voisins qui se plaignent du tapage, les rigolades complices, tous ces « moments forts » qu’on se jure de ne jamais oublier : qui, en France, ne l’a pas au moins vécu une fois ?
Une vie de bohème que celle de ces « brèves amitiés éternelles » pour paraphraser Andreï Makine :
Avec sa bande de héros, la maison était un phalanstère, une thébaïde, un kibboutz.
Désormais familière de l’univers et des « obsessions » d’écrivain du grand reporter, j’ai immédiatement reconnu les thèmes qu’il aime à traiter : la ville et ses mutations, la vie de province, la famille, les choix à faire à l’âge adulte, les liens d’amitié, précédemment joliment traités dans « Ce crime est à moi » et « Les amis de passage ». J’ai été tout de suite charmée, happée, emportée par cette plume dans laquelle on a envie de se lover comme dans une couverture sépia. Philippe Ridet manie l’art de la belle formule, de la tournure littéraire semée de lexique rare :
Il n’avait aucun souvenir de cette atmosphère agreste mais relayait au besoin cette mythologie familiale.
Qui est donc la « bande de héros » qui donne son titre au roman ? C’est ce groupe d’amis massé autour de Jean-Denis et qui envahit la maison parentale dès les adultes partis. Le lecteur rencontrera Ponthus (déjà croisé dans le précédent), Harold, Walter, Alain, Livia, autant de figures qui incarnent une période de la vie à jamais révolue, et synthétisent les problématiques de la jeunesse de la France périphérique : certain désœuvrement, indécision quant à l’avenir, partir ou rester, est-ce s’encroûter que de rester dans cette petite ville ou faut-il monter à la capitale pour « réussir sa vie »? Le roman narre ces bromances, cette ambiance « les copains d’abord » qui émeuvra tout lecteur qui a gardé au cœur quelque vestige de ces années d’étroite amitié et d’insouciance, et jusqu’à cette langue réservée aux initiés, avec ses propres références et ses clins d’œil :
Sympathie immédiate, compréhension tacite, reconnaissance au premier coup d’œil (…) nous faisions de l’ambiguïté une esthétique.
Tous un peu dépassés par « l’excessive patience que nécessitait l’accomplissement d’un destin », les comparses étirent à loisir ces soirées bien arrosées, dans l’illusion touchante d’une éternité, d’une pérennité de cette période dorée. On note que la seule fille de la bande, Livia, est peut-être celle qui est la plus réaliste, la plus rapidement lucide sur l’avenir du groupe, dont elle sera d’ailleurs l’une des premières à se détacher. Nous suivrons l’un d’eux dans une mission au Liban qui se soldera par un retour rapide, le mal du pays étant décidément trop puissant. Ce qui fait dire au narrateur cette phrase au caractère irrémédiable :
Un jour, nous serions confondus avec la ville, elle nous engloutirait comme un boa (…) Bientôt la ville ne sera qu’une buée.
Car la ville, comme dans les autres romans de Phillip Ridet, est un personnage à part entière, doué d’une force d’attraction sur les personnages, un espace connu sur le bout des doigts et dont il est difficile de s’éloigner tant s’attachent à lui une kyrielle de visages et de souvenirs.
L’auteur avait déjà longuement traité des mutations de la ville de province dans son premier texte et avec quelle finesse d’observation il avait brossé ses portraits successifs. Cette fois, c’est la ville en tant que cadre privilégié des souvenirs de jeunesse, comme décor sentimental douloureux à abandonner sans une impression de trahison qu’elle est évoquée. La question de la fidélité (aux gens, aux réminiscences), de la loyauté au groupe est subtilement relatée dans cette atmosphère festive où l’on sent déjà poindre les ruptures à venir et ce, malgré l’impression permanente alors que « demain sera une autre fête ».
Philippe Ridet parle également en fin connaisseur des relations amoureuses de la vingtaine, à travers le couple formé par Ponthus et Nicole, le fossé qui se creuse, les incompréhensions, le désamour, le désillement, les paradoxes des reprises d’affection, l’impression de « banalité » passée la période de fascination :
Dès cet instant, il sut qu’il allait la perdre et l’en aima davantage.
Un texte mélancolique qui pourtant renferme bien des moments cocasses, notamment cette scène de l’intervention de la voisine lors d’une fête particulièrement bruyante. J’ai ri à voix haute dans mon lit quand elle dit que les jeunes poussent des « cris de singe » et que tous ont « passé l’âge des bamboulas »… Irrésistible car le lecteur « entend » ces mots, ces expressions que produit le choc des générations.
Un roman diablement attachant, à la fois poignant et drôle, d’une tendresse absolue, et qui bat en brèche avec une grande empathie les idées reçues, romantiques, sur l’amitié indéfectible qui nous suit toute une vie.
Avec réalisme mais non sans émotion, Philippe Ridet revient sur les traces de ces souvenirs marquants, vécus à un tournant existentiel, que le temps n’a pas tout à fait effacés. Ressuscités par l’écriture, ces moments fragiles mais pourtant indélébiles, reprennent vie et embarquent avec lui le lecteur qui s’identifie. Et de comprendre qu’en vieillissant, on ne saurait retrouver la saveur et l’intensité de ces liens adolescents, que les relations matures ont hélas souvent cette « fadeur » propre aux attachements raisonnables.
« La nostalgie, cette métastase de la mémoire », écrit Philippe Ridet, et pourtant quelle douceur elle confère à l’écriture, sans jamais sombrer dans le regret stérile. Et cette phrase de Pierre Loti, si sobre et si belle, qui résume si bien ces âmes sur le départ, déchirées entre enracinement et arrachement :
« Souffrir de partir et pourtant l’avoir voulu. »
Absolument magnifique.