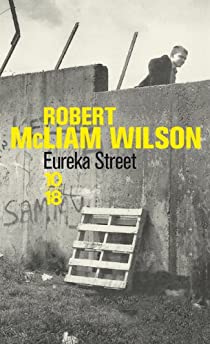« Où est la lumière de ta vie, ce soir ? »
Comment parler d’un très grand livre ? En proposant un compte – rendu exhaustif de ses qualités ? En rendant hommage, dans un mouvement de gratitude éternelle, à celui qui vous a permis de le voir atterrir entre vos mains ? Sans doute les deux. Encore qu’ici, je me contenterai de la première partie, la seconde est certainement trop personnelle et intime pour être clamée publiquement.
Voilà donc un chef d’œuvre qui tient finalement à peu de choses : un savoureux mélange de tendresse, de grossièreté, de poésie et de violence. Un récit parfaitement cadré, exactement huilé, qui déploie toute sa puissance de l’universalité de son propos.
Dans un Belfast dévasté par les luttes terroristes fratricides entre Catholiques et Protestants, nous suivons une galerie de personnages, tous truculents, émouvants et imparfaitement humains. Dès les premières lignes, le lecteur est saisi par la perfection de la langue employée.
Gloire à Brice Matthieussent pour son impeccable traduction, un exercice de style absolument magistral qui restitue aussi bien l’oralité la plus triviale des piliers de comptoir (haut niveau d’argot parfois) et la délicatesse du regard qui se pose qui sur la ville nocturne, qui sur des corps désirés.
Belfast est magique. Cette nuit-là, les rues exhalaient une odeur lasse et éventée, l’air est plein de regret et de désir. Le temps semble passer et passé. La ville apprend à vieillir. Dans chaque rue grouillent les signes émouvants des milliers de morts qui les ont arpentées. Ils laissent leur odeur vivace sur le trottoir, sur les briques et les seuils et dans les jardins. Les natifs de cette ville vivent dans un monde brisé – brisé, mais beau. Une nuit, arrêtez-vous dans Cable Street, laissez le vent vous donner la chair de poule et écoutez, tout raidi d’extase, le passé anonyme qui vous parle. La ville est un roman.
Dans ce cadre urbain dont les descriptions saisissantes, lyriques, n’ennuient jamais et tendent à faire de la cité un vivant, vibrant personnage, Robert McLiam Wilson campe deux personnages centraux, deux amis de longue date, Chuckie Lurgan et Jake Jackson. Deux individus très différents mais deux symboles complémentaires : l’un est un capitaliste obsédée par l’argent et la chair des femmes; l’autre est un poète rêveur et bagarreur qui ne rêve que du grand amour et flanche à chaque silhouette féminine croisée.
Tous deux sont des gentils loseurs attachants, qui noient leur difficulté d’être dans les litres de pinte du Wigwam, le bar où leur bande a ses habitudes. Autour d’eux gravite toute une galerie de personnages que l’on découvre peu à peu. Les liens se tissent, les aversions se renforcent au gré de querelles politiques plus ou moins sérieuses.
Une certitude : j’ai rarement lu une telle finesse psychologique dans la peinture des différentes âmes que nous rencontrons. La force de ce livre, c’est aussi son humour omniprésent. Je me suis plusieurs fois retrouvée à rire tout haut face aux innombrables traits d’esprit, répliques irrésistibles, (trouvailles lexicales du traducteur, éblouissantes), situations cartoonesques de cette merveilleuse brochette de bras cassés.
Pourtant, l’arrière – plan d’Eureka Street ne prête guère à la gaudriole : l’un des chapitres décrit avec une minutie tragique, l’explosion d’une bombe dans une ruelle. Et ses conséquences, et les traumatismes, et les morceaux de vie répandus partout, et les larmes qui n’y peuvent rien. On changerait les noms, et voilà Paris, Bagdad, Nice : anonymes décimés au nom d’une guerre qui ne sait même plus ce qu’elle combat.
L’auteur rend, avec une compassion immense, un bien bel hommage à toutes ces vies fauchées sans raison, faisant d’une scène singulière un tableau universel, un douloureux écho actuel.
Une partie des présentoirs lui avait entièrement arraché une jambe en le blessant gravement aux hanches. Le verre de la porte lui avait ouvert le visage en deux. Il s’appelait Martin O’Hare. Il avait été à l’école. Il avait lu Les Grandes Espérances et voulu devenir astronome. Il était tombé amoureux de plusieurs personnes et plusieurs personnes étaient tombées amoureuses de lui. Il avait une histoire, lui aussi.
Cette compassion, ce regard empathique sont une donnée permanente du récit. Ce qui lui donne sa vitalité humaine, sa sensibilité. Jamais de sentimentalisme, jamais de clichés : l’auteur évite tous les écueils dramatiques et pourtant bien des passages embuent le regard.
C’est un homme qui comprend soudain la vulnérabilité de sa mère et saisit, en un claquement de doigt, tout l’amour qu’il lui porte sans avoir jamais osé se l’avouer. C’est un homme qui panse avec difficulté un cœur meurtri par les échecs amoureux. C’est un jeune garçon battu, abandonné, qui trouve encore la force de rire. C’est un livre à la fois tragique et fondamentalement optimiste.
Un livre qui donne envie d’aimer la vie, d’embrasser toutes ses couleurs et ses rebondissements. Qui célèbre l’audace, l’ambition, l’amitié et, évidemment, l’amour. Un livre qui donne envie d’ouvrir les yeux sur toutes les beautés du monde.
Un livre richement documenté, caustique, ironique (Quelle charge porte l’auteur sur les médias et les politiques ! ) – d’une intelligence redoutable. Un livre nécessaire, plein de bruit, de fureur et pourtant si empli de douceur, à lire absolument – toutes affaires cessantes.