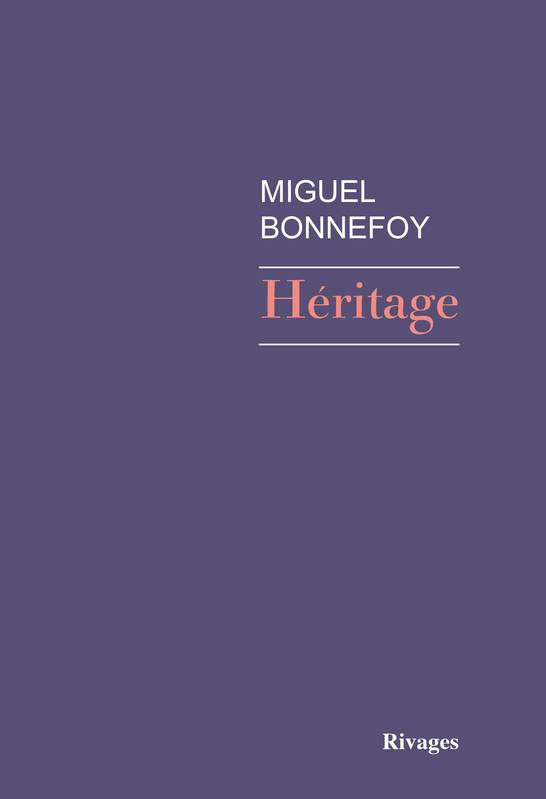Cent ans de Chilitude
On commencera par parler de l’héritage « Garcia-Marquezien » de Miguel Bonnefoy, déjà présent dans le très beau Sucre noir, mais définitivement confirmé (et avec quel brio) dans cet Héritage, sûrement le roman le plus abouti et le plus personnel du jeune prodige franco-vénézuélien des lettres tricolores.
Miguel signe ici une saga familiale ambitieuse et forte en saveurs qui s’étend sur un siècle et dispense ses parfums entre l’Amérique du Sud et la France. Le scénario de départ a fait remonter à ma mémoire la musique de la série Terre Indigo, et la couverture de Rivages n’y est pas pour rien.
Le lecteur rencontre la dynastie des Lonsonier et des Lamarthe, dont les deux premiers membres (Lazare et Etienne) arrivèrent de France à la fin du XIXe siècle, l’un ruiné par le phylloxera mangeur de vignes et débarqué à Santiago un cep en poche, l’autre les valises pleines d’instruments de musique. L’auteur a l’art d’enfanter des personnages au destin flamboyant, souvent tragique, portés par un souffle romanesque et des phrases denses, amples, au rythme océanique.
On peut trouver ces excès lassants, ou par trop systématiques, mais ils sont pour moi le signe de cette parenté luxuriante avec l’auteur de Cent ans de solitude, qui n’hésitait jamais à s’exprimer avec couleurs, emphase et exotisme. Il y a dans la prose de Miguel Bonnefoy une vitalité, un oxygène narratif qui sentent l’épopée et qui dépaysent au plus haut point. Nulle tiédeur, nulle demi-mesure ici : chaque personnage s’empare de sa destinée au lasso, refuse les compromis, tient tête à l’injustice, ne se laisse jamais abattre. En cela, Héritage est une sorte de manuel de stoïcisme.
À la suite de Garcia Marquez, Miguel offre une place de choix au fameux réalisme magique, qui n’est autre que l’étonnante irruption du fantastique au beau milieu du quotidien. Comme le merveilleux des contes, il est une convention dont il faut accepter les règles : ainsi, nul ne sera surpris de voir surgir un fantôme plus vrai que nature, un vieux marabout faiseur de miracles et des signes ayant valeur d’augure. J’ai trouvé ce livre d’une grande beauté formelle, avant toute chose. Son paragraphe liminaire est d’une perfection à ravir :
Lazare Lonsonier lisait dans son bain quand la nouvelle de la Première guerre mondiale arriva jusqu’au Chili. À cette époque, il avait pris l’habitude de feuilleter le journal français à douze mille kilomètres de distance, dans une eau parfumée d’écorces de citron, et plus tard, lorsqu’il revint du front avec une moitié de poumon, ayant perdu deux frères dans les tranchées de la Marne, il ne put réellement séparer l’odeur des agrumes de celle des obus.
On trouve dans ces quelques lignes tout le génie narratif de Miguel Bonnefoy, ce cocktail sensuel et épicé de légèreté et de douleur, ce sens de la scène et de l’anecdote, ce tissage de cocasserie et de gravité, où se devinent déjà les thèmes à venir. Plus même que son récit incroyable et la sagesse proverbiale qui le sous-tend, ce sont les manières d’aède de Miguel Bonnefoy qui m’ont fascinée.
Une voix habitée, inspirée, malicieuse et chantante, qu’on dirait venue du fond des âges, issue de la plus belle tradition orale. Miguel a ce timbre de conteur de veillée au coin du feu et des ressources pour tenir en haleine son lecteur (« elle devait se rappeler bien des années après », « rien ne laissait présager », « on raconta plus tard ») en distillant des informations sur l’avenir des personnages qui ménagent habilement le suspense et l’attente. Les images qu’il déploie sont toutes singulières, les épithètes grandioses, la langue employée toujours inattendue, d’une grande poésie :
À cinquante-deux ans, Delphine avait perdu l’intensité vermeille de sa chevelure de dahlias. (…) à travers des champs de luzerne, où le crépuscule avait la couleur des gencives des pumas. Elles grandirent dans un univers d’opéras et de symphonies, étudièrent le solfège avant l’espagnol et leur premier mot fut une note. (…) des hommes aux mains comme des serres qui voyaient des présages dans tous les vols et dont l’habitude d’assister aux prédations de leurs faucons avait redoublé leur résistance aux tendresses de l’amitié.
Miguel semble avoir écouté le conseil d’André Breton qui disait de toujours chercher la métaphore inouïe. Pour couronner le tout, il nous régale d’un lexique très pointu (botanique, culinaire, militaire..) qui signe la richesse de sa langue et son exigence à la fois sémantique et documentaire. Ce roman est d’ailleurs une véritable déclaration d’amour à la France et avant tout au français qui, aussi hallucinant que cela puisse paraître, n’est pas la langue maternelle de Miguel.
Même s’il est peu question de l’Hexagone au sein de ces 207 pages, ce texte, dans sa forme aux trouvailles stylistiques innombrables, constitue en lui-même un hommage poignant. L’auteur réussit à combiner de façon millimétrée vent métaphorique et vocabulaire de précision, via une convocation remarquable de tous les sens. En cela, Héritage est une ode à la vie : fragrances, coloris, correspondances, synesthésies, musique, sensations.. Tout explose sous les yeux éblouis du lecteur qui ne reviendra pas d’un tel feu d’artifice.
Les thèmes abordés par l’auteur sont multiples et foisonnants, à l’image de son style : Hugo n’a-t-il d’ailleurs pas dit que la forme, c’est le fond qui remonte à la surface? Il est question du mythe du pionnier, de deux guerres mondiales et de leurs désastres sans nom, de déracinement et d’enracinement, de migrations, de ce que nos aïeux nous lèguent (voir titre), de ce qu’il faut d’abnégation pour tenir sous la torture, de passion chevillée au corps (pour l’aviation, les oiseaux..) et qui tient debout, de patriotisme et de soif d’aventure et de la mort qui frappe avec ou sans sommation.
Comme tout chef d’œuvre, Héritage mêle grâce et pesanteur avec une même maestria, passant avec aisance des malentendus les plus cocasses (celui du nom de départ, celui des aviateurs qui lévitent…) aux geôles de torture les plus sordides de la dictature chilienne (passages terrifiants de déshumanisation qui m’ont rappelé un mélange de Mapuche de Caryl Férey et de Luz ou le temps sauvage d’Elsa Osorio). J’ai également aimé que l’auteur saupoudre (sans excès) son récit de vocabulaire espagnol, qui apporte une touche de folklore et de pittoresque très attachante.
Enfin, Héritage est un grand roman féministe, au sens le plus noble du terme, un roman peuplé de femmes fortes, combattantes et combatives, qui ne s’en laissent pas conter, prennent en main leur destin sans rien attendre des hommes, des femmes sauvages et passionnées, éprises d’absolu, prêtes à « embrasser une vocation et y mourir ». Thérèse et ses oiseaux de proie, puis Margot l’aviatrice (quelle ode à la liberté !), la mécanicienne aéronautique, la risque-tout un peu tête brûlée : il y a chez les Lonsonier un élan, un allant et une force ataviques qui traversent toutes les générations.
On ne saurait dire si cette famille est plutôt matriarcale ou patriarcale car chaque personnage est doté d’une forte personnalité, mais je note que le vieux Lonsonier atteint un âge biblique avec ses 108 ans… Et que dire de ce mystérieux aïeul français, Michel René, qui parcourt la légende familiale tel un fil rouge, et qui est un peu comme un certain Monsieur Piekielny, que chacun doit retrouver, mais dont nul ne sait s’il est une créature inventée ou un homme véritable ? De roman en roman, Miguel Bonnefoy trace une grande œuvre insolite, une gigantesque fresque bigarrée à l’imagination débridée, qui tire sa puissance de l’âme même de cette Amérique du Sud à la fois vécue et rêvée, passée au tamis d’une fabuleuse culture littéraire.
On notera qu’on retrouve un Bracamonte, famille déjà présente dans Sucre noir, qui revient ici tel un clin d’œil au lecteur ayant bonne mémoire. Ainsi de ces pages éblouissantes, pleines de bruit et de fureur, de larmes et de saveurs, sur lesquelles souffle un vent légendaire, mythique, venu de loin, entre Steinbeck et Garcia Marquez, qui font de ce roman-monde à la fois une odyssée à cheval entre deux continents, un roman initiatique, une tragédie, un poème en prose, une virée exotique et une plongée au cœur des mutations du XXème siècle : en un mot comme en cent, un très, très grand roman.