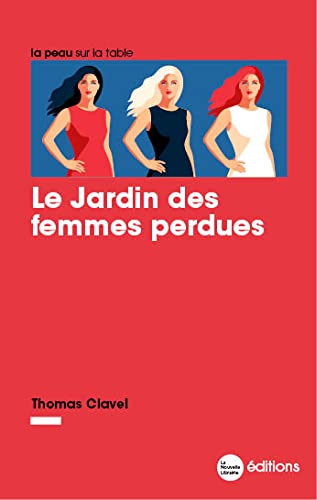Laideurs et misères des courtes âmes
Thomas Clavel semble s’être spécialisé dans ce qu’on appelle le « roman à thèse ». Son précédent roman, « Un traître mot », s’attaquait à la police du langage et ses dérives tyranniques ; ici, « Le jardin des femmes perdues » nous parle des femmes prises dans les filets du wokisme et des difficultés qu’il engendre dans les relations avec le sexe opposé.
Le romancier entrecroise les carnets intimes de deux voisins de palier, Victor Sabran et Magali Bavoir. Le premier est un vague consultant dandy (qu’on ne voit pas bosser beaucoup) dont le quotidien se résume à désirer des femmes, à les séduire et à les attirer chez lui ; la seconde est une prof de collège dégénérée dont le cheval de bataille est la « déconstruction » des préjugés sur les hommes et les femmes, le genre, les races etc (et qui espionne avec rage son voisin qu’elle agonit d’injures en pensée).
Tous deux sont des caricatures au service d’une démonstration et c’est à la fois la qualité et le défaut de tout roman à thèse : l’entièreté du scénario n’est qu’un prétexte pour exposer et illustrer des idées bien précises, et l’ambition littéraire passe un peu au second plan, même si le texte est très bien écrit au demeurant.
Ce que j’ai d’ailleurs trouvé fort avec ce texte, c’est la capacité de Thomas Clavel à passer d’un registre de langue à l’autre. Alors que le parler de Victor est d’un élégant classicisme (confinant à une préciosité un peu pénible à la longue), le phrasé de Magali est tout ce qu’il y a de plus écervelé, contemporain, oral et populaire (« il avait le smile », « un gros kiffe »). La dextérité de l’auteur à jongler entre le langage familier et le langage soutenu m’a épatée.
« Nous parlâmes gilets jaunes, bonnets rouges, tabac gris et péril brun. »
Thomas Clavel livre bien une charge acerbe contre les délires du néo-féminisme en inventant un personnage de femme qui cumule toutes les tares (et les paradoxes) de cette folle idéologie : frustrée détestant les hommes (mais rêvant de s’en faire aimer), pourfendeuse des « races » (mais capable d’essentialiser les Africains), militante de l’identité de genre et de l’écriture inclusive, hargneuse à défendre son corps dont elle revendique le droit à la laideur, pro-migrants (du dimanche), spécialiste de la « charge mentale », admiratrice des collectifs de colleuses d’affiches agressives et autres manifestations de la « sororité »… Rien ne semble avoir été omis à cet insupportable tableau qui m’a rappelé le « serment sur la moustache » de Samuel Piquet.
Des institutions facho et virilistes comme les églises ou les agences bancaires
Victor est un peu moins insupportable, un peu plus « classique » dans le genre joli cœur macho, amoureux des femmes et passant son temps à célébrer leur beauté, mais son attitude finit par être pesante, par son caractère maniéré et poseur. Le garçon se prend de plein fouet la réalité du discours de femmes qu’il courtisait pour leur simple apparence et qui se révèlent quasiment toutes des pasionarias hélas très consensuelles de tous les « combats » à la mode. Toutes vont dans le sens du vent, aucune n’a de personnalité propre, toutes illustrent un mélange de crédulité et d’intolérance intellectuelle. (Un livre à offrir à la rédaction de Causette et à Lauren Bastide et ses affidé.e.s.)
Le désir masculin est criminel
L’incompréhension entre les hommes et les femmes, la rupture de leur échange (qui devient dialogue de sourds) sont absolus. Magali non plus, de son côté, ne s’en sort pas mieux. Son Malien croisé à la soupe populaire finira lui aussi par la décevoir et lui fera dire in fine que tous hommes sont des connards. (sans parler de sa fureur dès qu’un regard s’attarde dans le métro…)
L’auteur s’en prend aussi au narcissisme qui sévit sur les réseaux sociaux, au culte de l’image qui attise, piège et assèche in fine les désirs par trop d’exposition :
La Toile avait été conçue pour engluer le désir de l’homme.
Le roman pose la question des sites et autres applications de rencontres, qui ne sont en fait pour Victor qu’un moyen de « corrompre l’art éternel de l’abordage par la frauduleuse intercession d’une machine. » Magali enchaîne les « dates Tinder » foireux (sans jamais tirer les bonnes leçons, c’est toujours la faute de l’homme), ce qui ne fait que renforcer sa radicalité et sa haine féroce de ce dernier (« l’enfer masculiniste ») toujours plus voué aux gémonies de l’hystérie woke.
L’auteur en profite aussi pour pointer les éloquentes mutations de la ville, comme ce remplacement par un KFC de la (sublime) librairie Vrin, place de la Sorbonne.
Même si on est heureux de quitter ces personnages exaspérants, il faut reconnaître là le talent du romancier qui est de ne jamais nous laisser indifférents et d’exacerber nos émotions au service d’une démonstration contemporaine.
Un roman au vitriol et plein de drôlerie de l’excellent Thomas Clavel, encore !