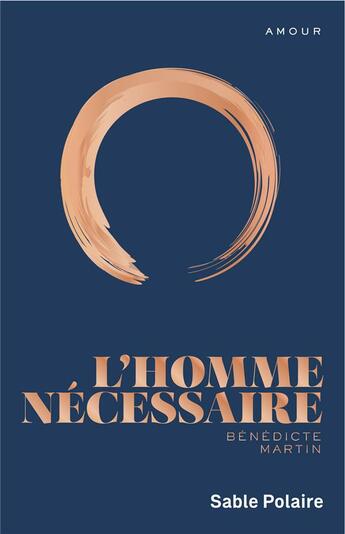Toi et moi contre le monde en ruines
Déjà, il y a l’objet-livre, imaginé par l’éditeur Stéphane Million et qui fait déjà de cette œuvre un lingot : une couverture veloutée, marine et moirée, sertie du mot « amour ». Nous savons à quoi nous attendre. Et puis en fait, non. Ou du moins, pas que. La quatrième de couverture de l’un des romans à clef de la dernière rentrée littéraire est par trop parcellaire. Bien sûr, elle dit fort bien le versant érotique, poétique et passionnel de ces pages inspirées par un amour absolu, digne de celui de Camus et Casarès. La romance fusionnelle, si romantique, de deux âmes jumelles :
Tu es couleur de rendez-vous.
On se disait qu’on détestait beaucoup de choses. Les télés, les séries télé, les gens emmaillotés devant les séries télé. Les vies contemporaines qui giflaient la poésie. La marche à suivre actuelle qui ôtait de nos existences les derniers substrats de grâce. On déplorait que les gens n’écrivent plus sur leurs genoux, le cahier tordu, le stylo dérapant. On regrettait la perte du vertige du voyage que le romantisme allemand désignait sous le nom de wanderlust. Mais maintenant que j’ai refermé, les yeux humides, le livre de Bénédicte Martin, je dirais qu’il est bien autre chose aussi. Bien davantage que ce journal éblouissant d’un amour qui le fut tout autant. L’homme nécessaire est, à l’image de son auteure, un récit hybride, métis, aux influences ambitieuses, héritages nombreux et bel intertexte.
Un flamboyant mélange d’autofiction cathartique, de pamphlet écologiste catastrophiste, mais aussi un hymne à la liberté, à la beauté du monde, à la jouissance et à la puissance féminines. Il y est à la fois question du corps, du désir, de féminité, de voyage éperdu à la recherche de la fusion absolue, de mélancolie d’amour, d’absence de faim, de ces trains que l’on prend pour se fuir, de renaissance, de sexualité, de la splendeur de la Terre en sursis gâchée par les activités anthropocènes, et surtout – surtout – de l’urgence de jouir, d’aimer et de tenter l’extase face à l’apocalypse qui vient. Le hasard veut que je lise ce livre juste après Trois fois la fin du monde de Sophie Divry qui est un roman post-apocalyptique. Avec Bénédicte Martin, me voilà plongée dans un récit pré-apocalyptique, initiatique & quasi-mystique.
Les pages de cette spécialiste de Colette sont truffées de poésie et de fulgurances étincelantes – on sent à la lire que Bénédicte a beaucoup lu et parfaitement digéré ses mentors (poètes comme Yeats, Michaux ou Desnos, écrivains voyageurs comme Conrad) – ses écrits sont infusés par ses maîtres de la plus belle des façons. Toutefois, L’homme nécessaire ne plaira pas à tout le monde car il est par moments d’une radicalité déconcertante, tout comme l’est la crudité impudique de son érotisme. Bénédicte appelle une chatte une chatte, point barre, il y a du foutre et du cul, et il ne faut pas s’en étonner.
Ceux qui s’en offusquent sont des puritains qui oublient d’où ils viennent. J’aime que les femmes s’emparent d’un langage longtemps réservé aux hommes. Ce roman m’a évoqué le film Love de Gaspar Noé en ce qu’il est aussi une magnifique histoire d’amour qui fait la part belle au sexe et à un hédonisme ré-joui-ssant :
Nus dans le bain, on fut grappe de déraison, passion, ablutions, raisins en dégustations et fellation. Nus et à deux, ce soir-là, on fut paresse et caresses dans l’abondance et la bombance. Je vivais avec lui l’existence extraordinaire, l’existence extatique, la folie parfaite des personnes qui font des voyages au long cours. On a dépassé le Mont Altaï et il a déroulé le long ruban blanc de mes jambes le long de ses flancs. On a achevé toutes ces journées de kilomètres de baisers. On n’a pas distingué le tien du mien pendant des heures. Il m’a dit en sueur que les femmes d’avant ne valaient rien et que sur terre, il n’y avait plus que mes seins.
Moi qui suis de celles qui souvent plombent l’ambiance de leurs certitudes alarmistes quant à la proche fin du monde, je découvre ici une sœur de pensée et cela m’émeut et me rassure. Seul un livre peut vous procurer ce dialogue d’âme à âme, et c’est en cela qu’il est précieux. Bénédicte Martin est à la fois Cassandre (elle émaille son texte d’un édifiant inventaire très documenté de toutes les menaces qui pèsent sur l’humanité, ces innombrables successions d’alarmes cataclysmiques, revenant même sur les textes bibliques qui évoquaient déjà les catastrophes climatiques que nous connaissons) et Antigone puisque cette conscience de la fin du monde génère chez elle une détresse totale qui l’empêche de mener une vie équilibrée, et qu’elle combat à grands coups d’anxiolytiques – et qui m’évoque cette ligne d’Anouilh :
Il y aura toujours un chien perdu quelque part qui m’empêchera d’être heureuse.
Bénédicte est une de ces hypersensibles que l’angoisse dévaste, sur laquelle pèse une urgence silencieuse. Une insécurité existentielle qui va peu à peu muter, se sublimer au cours de 285 pages magiques qui s’achèvent en une somptueuse acmé sensorielle, un ballet extatique de couleurs et de paix intérieure. Une félicité baptismale qui n’est pas sans rappeler le feu d’artifice final du livre d’Olivia de Lamberterie. Soudain, celle qui s’était perdue se retrouve, la femme et la mère qui doutaient prennent conscience de leur pouvoir – invitant chaque femme à s’emparer de son destin.
On sent bien là l’influence exercée par Simone de Beauvoir (dont Bénédicte est spécialiste) : ce récit incarne le long et difficile cheminement de la femme pour trouver sa place et devenir ce qu’elle doit être. L’homme nécessaire est un livre-tsunami courageux et sincère, au style à la fois direct et chatoyant qui emporte et inspire et donne à comprendre que chaque femme doit être l’héroïne de sa propre vie. C’est aussi le portrait d’une femme complexe, intelligente et excessive, à la fois femme fatale et femme-enfant, pour qui l’amour absolu est un idéal existentiel à embrasser pour se sentir pleinement vivant. Le voyage aussi, le retour à certaines lointaines racines sont également au cœur de la démarche de Bénédicte Martin qui, par sa plume sensuelle et colorée, parvient à nous rendre bruits, teintes et odeurs de Singapour ou de Sibérie de manière merveilleusement ramassée et évocatrice :
Ici, le calme, ici la beauté. Ici, la vie. Ici les eaux de Mongolie mêlées au fleuve Amour de la Russie. Ici des nuages coulant sur le lac. Ici un chaos de blanc, de bleu et de rose pastel. Le bleu. Ce bleu-là. Ce bleu, il faut qu’on en parle. Ce bleu-là, à moins d’aller là-bas, vous ne le connaîtrez pas. Ici on dit que la divinité suprême du chamanisme sibérien est l’éternel ciel bleu. C’est un bleu épanoui dans du lait. C’est un bleu évanoui sur la lune. C’est un bleu de noblesse, c’est un bleu d’yeux de déesses. C’est un bleu qui pour toujours n’appartiendra qu’à nous deux.
J’ai également beaucoup aimé les passages chez son père, ce refuge qu’elle trouve chez lui pour tenter de soigner son désespoir amoureux. Quel homme sage, et comme ses conseils sont brillants et délicats, pleins d’encouragement et de tendresse. Un vibrant hommage à l’amour filial, à ce que nous devons à nos parents, à l’héritage que nous en gardons.
Il m’a dit : « Et souvent il y a plus de bravoure à se retenir et à passer : pour se réserver pour un ennemi plus digne. Au lieu de faire des conneries, tu devrais relire Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche. Quelle féministe es-tu quand tu es amoureuse ? Je veux bien être le père d’une femme triste, mais pas le père d’une femme faible. (…) Ta mère et moi, on t’a fait avec un sang neuf. Toutes les ruptures sont la condition des libres. Et là, je ne parle pas de lui, je parle de toi. Rassemble tes forces vives de métisse et choisis-toi.
L’homme nécessaire est ce récit d’une faim de lui sur fond de fin du monde. Ou celui d’une faim du monde sur fond de fin de lui, on ne sait plus. Un livre grandiose, un road-trip initiatique qui donne envie de se presser vers son désir dans une passion incandescente, inoubliable. Un ouvrage tourmenté, brûlant, urgent et mélancolique – et un objet somptueux – à lire absolument.
Mais franchement, étais-je la seule à savoir que nous étions perdus d’avance ? Une génération sans tombeau, sans lettres d’or sur les pierres violettes des cimetières, sans caveaux, sans épitaphe et sans sanglots. Nous étions l’ultime génération de l’humanité et pas grand monde n’avait l’air de s’en soucier.